
|
Lectures
de
Pierre
Jean Jouve
|
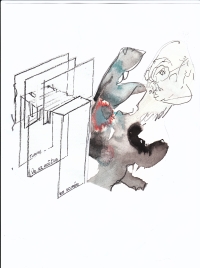
Retour à la page d'Accueil de la rubrique Lectures de Pierre Jean Jouve
Le motif du jardin dans
Dans les Années profondespar Éric Dazzan
Le motif du jardin, pour le moins traditionnel ou hérité d’une très longue tradition mystique et littéraire, apparaît dès 1909 dans Artificiel[1] et court jusqu’aux années du début de ce que le poète devait appeler sa vita nova, années au cours desquelles il semble s’imposer dans Paulina, Les Noces et bien sûr Le Paradis perdu. C’est dans cette œuvre, que Jouve décidera de placer en tête de ses œuvres poétiques, que s’explicitent et sont reliés à travers lui et le mythe biblique qui lui est associé les thèmes jouviens par excellence que sont la faute, l’exil, la clôture dans un désert d’images, de rêves et/ ou de souvenirs[2] et enfin l’impossibilité et le désir qui en découle de l’unité avec soi et avec le divin[3]. Il est donc à ce moment de l’œuvre devenu un symbole au sens où Jouve définit ce terme dans En Miroir[4], à savoir « le signe d’un objet pour l’étendue énorme d’un affect corporel » et c’est en tant que symbole que l’œuvre antérieure aura élaboré, un symbole riche donc d’un bruissement de paroles et d’images, que nous allons le voir revenir ponctuellement et souterrainement dans l’ultime récit publié par Pierre Jean Jouve, Dans les années profondes. L’auteur clôt alors une période de son travail ainsi qu’une étape de sa pensée[5].
Il est d’ailleurs intéressant de noter à ce propos que lorsque dans En miroir Jouve revient sur ce récit et tente de justifier son renoncement à l’art du roman (EM, 1102), il relève trois facteurs qu’il faut prendre en considération et dont un fait écho au motif du jardin et à son mythe et commande peut-être à l’interprétation des deux autres. Tout d’abord, « le travail d’invention s’est trouvé invinciblement ramené vers l’expérience concrète ». C’est pour éviter ce mouvement régressif et acquérir une liberté dans l’invention relativement à « l’expérience concrète » que Jouve choisit de s’en tenir désormais à « la seule libre Poésie qui, à aucun moment n’ayant été dans le jeu, ne devait rien à personne ». L’on voit au passage que « l’expérience concrète » engage non seulement le réel mais aussi la relation à l’autre et le jeu que cette relation suppose, terme à prendre aussi bien dans sa signification théâtrale et relativement au masque que dans ce qu’il laisse entendre d’interstice, de non ajustement ainsi que de fragilité et de potentielles fractures intérieures. D’ailleurs cette régression a deux conséquences qui très significativement vont se dire en des termes qui sont liés au mythe du jardin : si « le roman d’Hélène » a sa source et s’est nourri d’une culpabilité qu’il a permis de dépasser, ce travail a supposé ou exigé « une chute en arrière assez vertigineuse. ». La chute ici est moins expulsion d’un état premier que retour à ce dernier (ou du moins à un état antérieur) que caractérisent à la fois la culpabilité et donc le rapport à la faute ainsi qu’une expérience du réel qui se fait à travers la relation à un autre. L’on pourrait peut-être pour mieux entendre ce que concret veut dire dans l’expression « expérience concrète » relire le poème du Paradis perdu (PP, 53) qui s’intitule « La faute ». Entourée du serpent qui « l’inspire/ […] l’emplit, la transfigure », Eve qui présente le fruit à Adam gagne en matérialité et en souffrance, « ses seins durcissent sur le devant de son cœur/ Leur pointe est à vif et saigne dans l’obscur » comme si son sang exprimait – d’une manière toute baudelairienne – la lumière du démon. Ainsi, gagnant en matérialité et en souffrance, elle révèle et incarne la complicité de l’ombre et de la lumière, du plus haut et du plus bas, du plus vivant et du plus mortel[6]. Transfigurée par le démon elle devient cette matière désirable et désirante, lumineuse et obscure, cloaque et bonheur[7], qui fera naître en Adam la fureur et le transformera en bête sauvage. Elle devient la pure et terrifiante énigme qui est au cœur du réel et d’où jaillit une force transfigurante d’où peut naître aussi bien la poésie que la damnation dans le mal[8]. Dans cette perspective l’on peut comprendre que Jouve pose l’existence d’un « dessin secret » qui court « de Paulina à Hélène » et « qui ne veut pas être dispersé ou brouillé par l’apparition d’autres figures et d’autres problèmes. » Hélène nous est proposée comme la figure qui parvient à donner son unité et par là toute sa puissance à ce qui ne peut accéder à la lumière ni non plus être déchiffré. Comme Eve ou Paulina, elle a pour fonction d’imager – au sens de faire accéder à l’intuition ce qui est appelé à résister à tout effort de conceptualisation – une expérience du concret qui recèle à la fois une dimension panique et initiatrice. Si le travail d’invention permet de dépasser, c’est qu’il permet justement le retour à ce qui demandait à être repris et réélaboré. Ce travail de l’écriture qui commande au travail de la pensée, ne pouvait bien sûr être exigé qu’à partir d’une expérience concrète – la seconde partie de la liaison avec Lisbé – qui renouvelait elle-même une expérience antérieure ou plutôt l’ancrait plus fortement dans le concret tout en potentialisant la charge affective/ symbolique – la liaison avec la belle Capitaine H[9] – elle-même fortement marquée par l’inceste. Ainsi ce qui est en jeu avec l’écriture du roman d’Hélène, c’est cette tension entre une certaine expérience du concret et un complexe symbolique que l’on peut repérer dans le Paradis perdu ou bien Paulina 1880 qu’un expérience très concrète, rapportée à une personne, réveillera et remettra en jeu.
C’est cette expérience du concret, de la corporéité et de la sexualité, ainsi que de sa signification ou de sa charge symbolique que sera appelé à (re)faire Léonide dans Dans les années profondes. C’est à une certaine valeur du réel, c’est-à-dire à sa profondeur imageante et énigmatique qu’il sera confronté lorsqu’il rencontrera Hélène qui ne cessera jamais d’être corps et image, corps imageant une réalité fascinante et aliénante. C’est dans cette perspective que le motif du jardin réapparaît dans le travail de Pierre Jean Jouve, en tant que symbole que l’œuvre antérieure a élaboré et comme le signe que le poète est de nouveau en travail. En effet, le motif du jardin est un symbole d’autant plus fécond qu’il met en jeu et l’espace et le corps, qu’il fait coïncider finalement deux étendues : celle que Jouve rapporte à un « affect corporel », c’est-à-dire à la fois un signe et un potentiel de signification mais qui n’est pas éclairé par la conscience[10] ; et celle du jardin qui est une étendue spatiale dont la structure est bien souvent chargée de symbolisme, exprimant ainsi une intention (de signification) et qui de ce fait se donne d’emblée comme image tout autant que réalité. À quoi s’ajoute le fait que toute étendue spatiale, dans son déploiement comme profondeur et horizon, est en soi projection d’un mouvement du corps, advenir du corps à lui-même dans son mouvement et qu’en ce sens elle signifie (réfléchit) au corps ses intentions[11]. Le jardin, en tant qu’étendue chargée de symboles ou de symbolisme est donc par définition le lieu où se donne à voir/ entendre ce que le corps, dans ses mouvements comme ses affects, dit et dont la conscience ne peut se saisir. Et comme l’indique le mot affect, ce que le corps dit du/au sujet ou ce qui se dit par le corps et ses mouvements, c’est aussi ou d’abord une relation du sujet à ce qui n’est pas lui et qui l’affecte, modifie son âme, et c’est aussi un mode de relation et d’action qui suppose la passivité et ressort de la passion.
L’on pourrait donc considérer que le jardin, en tant que symbole et en tant qu’étendue qui engage le corps et ses affects, est, pour paraphraser Lacan, un espace structuré comme un discours, la figuration d’un inconscient qui agit le corps, de ce « dessin secret » qui selon Jouve relie Paulina à Hélène[12]. Il engage donc la question du sens et de ce fait il est intiment lié à la question du temps. En effet, il recèle un à-connaître ou un à-venir de connaissances qui met en jeu le rapport du sujet à lui-même et à sa condition. Et parce que le motif du jardin renvoie à une étendue qui est toujours déjà signifiante, toujours déjà en rapport de figuration avec le mythe de l’origine ou du plus originel dans l’expérience du concret, cette temporalité est aussi marquée par la reprise, la répétition qui seront la marque du mal et de la faute. Nous retrouvons tous ces éléments dans l’histoire de Léonide dont on verra qu’elle est reprise et approfondissement d’un toujours déjà advenu. Ainsi la transgression qu’elle met en scène est « une chute vertigineuse en arrière » dans le passé le plus originel. D’où l’atmosphère d’irréalité qui marque toute l’œuvre : connaître – et peut-être faut-il entendre ce mot dans sa signification biblique – c’est d’abord voir et s’approcher d’un secret que la mort, comme Satan avec le corps d’Eve, emplit et transfigure.
L’actualisation d’un drame très ancien
L’on peut au
moins relever trois occurrences du motif du jardin dans le récit intitulé Dans les années profondes[13]. La première
ouvre le récit et l’oriente de manière décisive. L’incipit de cet ultime récit est, comme on le sait, consacré au
paysage que l’on aperçoit de Sogno, à ces régions dans lesquelles s’intègre
« le val aux formes fraîches et rêveuses de la Bondesca », val
féminin par excellence, autre jardin que Léonide mettra tout le récit à quitter
et sur lequel l’œuvre de Pierre Jean Jouve ne cessera de revenir (DLAP, 961).
Ce tout début insiste sur ce qui est sans fin, inépuisable et sans terme,
et qui ressort moins du monde lui-même – ici les régions aperçues de Sogno – que de la manière dont il se présente
dans son mystère à la conscience et celle dont cette dernière s’en saisit. En
effet, le mot qualité qui ouvre la
deuxième phrase de ce paragraphe, mot dont la résonance pourrait être
bergsonienne, et qui fait écho à rapport
qui est le premier substantif du texte[14],
nous indique que ce qui « ne parvient pas à son terme » est d’abord
un contenu de conscience. Un contenu qui se présente dans/comme une image,
laquelle se définit traditionnellement par la mise en rapport[15], par
la figuration d’une signification et par l’affleurement de l’invisible. Ce qui
caractérise ces régions, c’est une sorte de d’instabilité, de tremblement ou de
mouvement par lequel elles s’offrent et à la fois se dérobent à la conscience.
Face à ce qui est ou se présente à sa conscience – et ce début de récit est
scandé par la répétition du présentatif « il y a » – le sujet semble
empêché de réaliser la synthèse qui permettrait à ces régions ou à ces paysages
de prendre une forme non seulement définitive, mais surtout définitivement
extérieure (objective ?).
Ce tout début nous indique donc au moins deux choses. Il nous indique d’abord que ces régions où se déroulera l’action, si elles sont réelles, valent pour ce qu’elles révèlent à lui-même et au lecteur d’un sujet (de ses états d’âme) qui cherche à objectiver/réaliser une intuition qui affleure en elles comme l’eau d’une source très profonde mais qui restera à l’état d’intuition (d’affects). Alors même que le paragraphe suivant nous donne Léonide comme le point de vue à partir duquel se déploie le paysage et qu’il nous fait entendre sous forme de discours indirect libre ses interrogations sur son destin, nous savons d’emblée que cette intuition qui lui est, dans le même temps, donnée et retirée, il lui faudra, pour l’actualiser en connaissance et faute de pouvoir l’éclairer tout à fait en conscience, l’agir en aveugle, comme dans un rêve, c’est-à-dire aussi l’exprimer en « affect[s] corporel[s] » et en mouvements qui dévoileront/ institueront un espace d’apparition/ manifestation[16]. Ainsi Soglio deviendra Sogno[17], faisant du rêve un seuil, de la perception une manière de rêve et enfin de l’action, lorsqu’elle est travaillée par le désir, la seule voie où tenter d’instaurer la relation à soi connaissante[18]. Par ailleurs, dans la mesure où le récit qui s’amorce dès le paragraphe suivant est un récit rétrospectif, il nous faut comprendre également que l’écriture de rétrospection est moins là pour amener cette « qualité » à « son terme » – élucider et épuiser un mystère donc – que pour renouveler cette proximité aveugle à un contenu de conscience qui ne parvient pas à aboutir/s’objectiver. Là encore, on pourrait songer, en lisant et surtout en écoutant ce premier paragraphe si musical et qui joue de la tension entre le multiple et l’unité, au Bergson de l’Essai sur les données immédiates de la conscience. Et peut-être nous faut-il considérer qu’un paysage comme celui que l’on voit de Sogno et le jardin jouvien qui en est le concentré symbolique ou qui le hante de son symbolisme ont pour fonction de musicaliser l’espace et sa représentation, c’est-à-dire certes de les temporaliser et dramatiser, en y intégrant les éléments d’un récit potentiel, mais aussi d’orienter cette temporalité et ce drame vers un hors-temps originel, de manière à laisser affleurer en eux une profondeur inépuisable et mystérieuse.
Il est d’ailleurs significatif que sous le regard rétrospectif de Léonide, le paysage de Sogno soit décrit au présent – et donné de ce fait comme un hors-champ narratif ou temporel – et que par sa structure d’étagement[19], il ressemble à certaines peintures du Moyen Âge qui réunissent dans l’unité de l’image et du regard qui la perçoit, spiritualité ascétique et sensualité, mort et vie. Il s’agit donc d’entendre à la lettre et dans ce qu’elle dessine le mot paradis qui ouvre le deuxième paragraphe. Ce que ce mot et sa lettre indiquent, c’est d’abord un rapport, un mode de relation à ce qui est à travers ce qui fut, à travers cette presque actualité/ actualisation et cette quasi présence d’un passé originel qui ne cesse de passer, dont le passage à travers les êtres et les lieux singuliers « ne parvient jamais à son terme ». Le jardin jouvien est d’abord un indicateur de cette manière de se rapporter à soi et au monde qui est d’emblée inscrite dans la répétition du drame le plus ancien et dont le sens pour le sujet échappe à la/sa conscience. Il est le signe et d’un exil et d’une proximité désirante/ magnétique à cette vraie scène où les vrais corps se tiennent. Aux personnages, il reviendra de rejouer éternellement le même drame d’amour et de mort, et de procéder au même sacrifice, aveugles et séparés d’eux-mêmes alors même qu’ils obéiront et accèderont à ce qui a tous les dehors d’un destin. Jouant plutôt que vivant une Passion qui les dépossède d’eux-mêmes parce qu’elle se joue toujours de l’autre côté du mur coloré des apparences, ils seront aussi, comme Léonide, voués à l’écriture. Mais Léonide a une ancêtre dans l’œuvre de Jouve en la personne de Paulina dont, la proximité au vrai lieu comme le désir et l’impossibilité d’y pénétrer se traduiront par le recours à l’écriture de son journal. Son parcours la conduira sinon vers le silence du moins vers une parole mesurée et rare. Lorsque Paulina réapparaît sous l’apparence de Marietta, elle est désormais sans histoire et peut-être morte à son histoire[20], et c’est peut-être la possibilité même du récit, de tout récit, qui s’est alors épuisée en elle, ou encore la nécessité de jouer, d’être dans le jeu et l’écart par rapport à soi. L’écriture, à laquelle Léonide va naître lorsqu’il sortira de ce paradis qu’est Sogno, est donc tout à la fois le signe d’une élection, d’une proximité au secret[21] et celui d’une malédiction qu’il s’agira d’épuiser comme Pierre Indemini semble y être parvenu à la fin de Dans le monde désert.[22]
L’on voit combien la phrase qui ouvre le récit proprement dit de Dans les années profondes : « J’allais quitter ce paradis le jour même », est importante. Ce futur proche, parce qu’il renvoie au plus originel, ouvre une sorte de parenthèse qui encadre d’a-temporalité la temporalité proprement dite du récit, une a-temporalité que la narration – le déploiement temporel de ce départ – va redoubler en quelque sorte dans la mesure où elle boucle le récit sur lui-même, le dernier chapitre évoquant comment l’écriture du récit et son impérieuse nécessité viennent à Léonide. L’histoire d’Hélène et de Léonide est donc fondamentalement figée dans ce départ, dans cette imminence d’un départ. Le motif du jardin, dans l’œuvre de Pierre Jean Jouve, est le signe/ l’indicateur de cette tension originelle entre l’immobilité et le mouvement, le temporel et l’a-temporel, la rétrospection et la fuite ou la marche en avant, en direction d’une signification originelle, destinale qui est à jamais inépuisable, et donc entre une intuition et son déploiement inachevable en contenus de connaissance.
Transgression
et culpabilité : mourir, la sortie du jardin
Cette transgression qui est traversée puis sortie du jardin, s’inaugure dans Dans les années profondes par le franchissement d’un seuil très particulier qui met en perspective tous les seuils qui seront franchis par la suite par Léonide jusqu’à la mort d’Hélène en plein acte sexuel. Pénétrer dans le cimetière de Sogno, c’est obéir à la perception d’un secret (DLAP, 962), c’est-à-dire à la perception d’un rapport entre plusieurs éléments de la réalité qui font alors image ainsi qu’à l’émotion que cette perception suscite. Mais c’est aussi passer de l’autre coté de l’image ou traverser cette image qui supporte la perception de ce secret et qui semble à Léonide résumer « la nature entière, […] son passé et son avenir […] avec son bonheur et sa mort ». Et c’est le faire en direction de ce que dans La Faute[27] Jouve appelle l’esprit noir, cette « immensité toujours cachée », que les images et la conscience recouvrent – et aussi qu’elles dénoncent, trahissent – « mais qui est », qui « colore [le sujet] de sa lumière d’enfer ». C’est enfin et conséquemment suivre des yeux d’abord puis en pensée, c’est-à-dire en deçà ou au-delà des images cette fois, un chemin qui conduit Léonide « jusqu’au cœur » de la mort (DLAP, 963). L’inscription par le personnage de son prénom sur le mur préfigure la fin du roman et un devenir écrivain qui ne peut se comprendre que relativement à la mort et à la transgression qu’elle suppose et que l’écriture aura pour fonction d’accomplir. Par ailleurs la rencontre apparition d’Hélène est précédée d’une autre transgression : le franchissement d’un premier seuil est suivi de celui d’un mur qui, enjambé, conduit Léonide cette fois « en dehors du village ». Entre la première transgression et la seconde le personnage aura traversé le jardin des morts et cette traversée l’aura disposé à un parcours initiatique qui s’accomplira dans un espace qui, tout en gardant les apparences de la réalité ordinaire, sera de part en part symbolique, traduction donc d’affects corporels. Dans cet espace où Hélène sera rencontrée et plus tard possédée, la vie semble s’accomplir sous le regard – sinon dans l’éclairage – de la mort et s’ouvrir ainsi à une profondeur qui en est la négation (le dépassement). Dans cette perspective, la rencontre d’Hélène ne peut se faire que dans un monde où tout est définitivement disposé à l’image ou à faire tableau mettant le personnage devant « quelque chose d’inépuisable et de mystérieux » dont la perception l’émeut et le met en mouvement, ouvrant devant et devant son corps l’espace qui deviendra la scène d’un drame. Pénétrer dans le jardin des morts, c’est donc pour Léonide commencer ce chemin qui le conduit, à travers les images, et dans une ambiance de plus en plus onirique, à sortir du jardin « aux formes fraîches et rêveuses de la Bondesca », à emprunter un chemin qui doit, à travers les images, le conduire au-delà, en direction de ce qu’elles indiquent, chemin qu’il reviendra à l’écriture de poursuivre et d’approfondir. Tout se passe finalement comme si Jouve, pour composer le début de son récit, avait superposé deux images (en apparence) contradictoires : la sortie du paradis, qui comme je l’ai dit sert de cadre a-temporel à l’histoire de Léonide et d’Hélène, ainsi que l’entrée et la traversée de l’enfer de Dante. À quoi s’ajoute, bien sûr, moins pour brouiller les cartes que pour créer une tension et une dynamique, une inscription dans les débuts de récit réaliste de type balzacien (19ème).
Transgression
et pulsion scopique : voir en rêve
Par ailleurs, comme le montre le tout début de ce récit la transgression spatiale, si elle traduit en mouvements et affects corporels une sorte de transgression intérieure (psychique) – c’est-à-dire finalement un cheminement intérieur en direction de ce qui est en profondeur et en dessous du sujet – ainsi que le plaisir qui en signale la perception[28], cette transgression spatiale est accompagnée et motivée par une transgression qui passe cette fois par le regard[29]. Non seulement Léonide pénétrant dans le jardin des morts, pénètre et s’inscrit dans une image et est appelé à poursuivre son chemin initiatique de transgression en transgression, d’image en tableau, mais chaque image-monde demande à être franchie par le regard, demande que le regard suive le chemin qu’elle indique vers un invisible dont le pressentiment, l’intuition envahit d’effroi et de désir le sujet. Et c’est bien dans un jardin encore où Hélène et Léonide sont descendus (DLAP, 989) que le verbe voir prend toute sa valeur, et que la pulsion scopique se dévoile dans sa proximité/ métonymie à la possession, au sens actif et passif, physique et psychologique (sinon religieux) de ce terme. Alors que le retour du mari d’Hélène est annoncé (ibid., 985) – retour qui fait naître une angoisse quoiqu’il soit naturel (ibid., 989), c’est-à-dire non seulement prévisible selon l’ordre (social, humain) des choses mais aussi inscrit de toute éternité dans la mécanique du drame originaire qui se rejoue – Léonide rêve de « la femme noire » dont il est amoureux et veut empêcher le « mauvais mariage » (ibid., 987). Les guillemets qui encadrent le verbe voir dans le dernier paragraphe, nous signalent qu’une modification profonde s’est produite dans le regard de Léonide qui aperçoit le drame dans sa totalité, c’est-à-dire dans une image très symbolique[30]. Non seulement tout est joué d’avance, les rôles y étant distribués et l’issue arrêtée, mais tout n’est que joué, reprise et répétition d’une action dont, nous l’avons vu le sens reste toujours à expliciter. Cette explicitation ne peut advenir que dans les corps et leurs mouvements. Et c’est ce passage du rêve à la réalité et la contamination de la seconde par le premier qui scelle l’enfermement dans la faute, c’est-à-dire dans la remontée d’un fond qui aurait dû rester refoulé, dans le plaisir qui accompagne cette remontée et enfin dans l’obéissance à ce fond et à ce plaisir qu’accomplit la mort. L’on peut comprendre ainsi la remarque du narrateur qui précède l’évocation du moment passé au jardin (ibid., 989) : « Je me souviens de cet après-midi d’enchantement, le dernier de liberté. » Ce commentaire ne se comprend pas seulement relativement au fait que la présence du mari risque de gêner les deux amants. Au contraire, elle est, par le mensonge qu’invente Hélène pour justifier la présence de Léonide à ses côtés, l’occasion de resserrer leur lien (ibid.). Il faut bien plutôt entendre que le retour du mari précipite un drame, au sens où il est un puissant accélérateur mais aussi où il boucle une situation et en permet ainsi le déclenchement/fonctionnement et donc l’acheminement vers la catastrophe (le dénouement). Léonide est donc dès lors pris au piège et cet empiègement a son préalable dans le passage au jardin et par le regard qui est possession. C’est bien, en effet, dans ce dernier après-midi de liberté que, librement, Léonide va prononcer la formule qui va définitivement l’enfermer dans un drame. On le sait, Hélène, prise d’une lubie, à l’aide d’une paille, produit des bulles de savons, « reflétant déformés le jardin et le ciel » (ibid.). Proposer à Léonide de souffler dans la même paille qu’elle, c’est lui proposer comme un baiser, un premier contact charnel. Le jeune homme refusera, préférant voir et trouvant « plus merveilleux de voir » (ibid., 990)[31]. Le baiser qui suivra, lorsque les deux personnages seront de retour à l’intérieur de la maison et qu’Hélène se sera perdue dans ses rêveries, oubliant la présence de son jeune amant, aura lieu dans une ambiance qui mêlera rêve et perception de la réalité et sera comme l’aboutissement rêvé d’une série de visions ou encore adviendra l’intérieur même de la vision (ibid., 991). Cette préférence pour le regard, pour la possession par le regard, n’exclut pas, on le voit, la dimension charnelle ou corporelle. Mais elle la submerge de significations, faisant des mouvements du corps la traduction d’une réalité toujours au-delà d’elle-même. Voir, embrasser « comme dans un rêve » (ibid.), ou encore embrasser comme on voit ou voir comme on embrasse, c’est s’avancer en direction d’une signification ultime et donc d’un acte ultime, obéir « à [la] tentation d’arriver à la « mort divine » dans la Chevelure » (ibid., 992). On comprend que dans un premier temps Léonide reprenne sa bouche, au risque de décevoir Hélène, mais aussi reprenne son regard, tentant « pour garder [son] allure d’homme » de la regarder « avec arrogance », lui jetant avec violence un regard qui dit le désir de possession mais qui n’est plus lui-même possédé. Pour autant, ce sursaut de liberté est-il assez éphémère. L’agonie de Pauliet servira de contexte à la réactivation de ce mécanisme de possession lorsque Léonide se masturbera, comprenant identiquement « ce qu’il fallait faire » et « ce qu’[il] voulai[t] , c’est-à-dire agissant « un sentiment qu’[il] ne pouvai[t] formuler » et qui « depuis le coucher du soleil […] cherchait sa voie » (ibid., 1019). Mais pour que le passage à l’acte ait lieu il lui faudra accéder à l’image d’Hélène, qui se tient debout, « toute entière et vivante » devant lui et qui le regarde. De la même manière l’éjaculation sera accompagnée d’une image qui signifie la faute tel que le texte de 1938 la spécifie[32]. Que cet acte qui mêle indéfectiblement le corps et l’image ou la vision soit lié à l’agonie de Pauliet n’est peut-être pas un hasard. Comme je l’ai noté plus haut, c’est par ce personnage que la mort et donc le mal passe et se propage. Mais c’est aussi de lui que Léonide va tirer ce qui, joint aux images qui obsèdent Léonide et qu’il tente de refouler afin de ne rien montrer au neveu d’Hélène, lui permettra d’y arriver, c’est-à-dire moins de passer du rêve à la réalité que d’y inclure cette dernière[33]. Voir, être vu, il y a là comme deux équivalents qui tous deux mettent en jeu les affects corporels, mettent le corps en mouvement et le propulsent ainsi dans un espace où ce qui est refoulé ou appréhendé avec mauvaise foi remonte en sa vérité de plaisir et de mort. Léonide ne pourra pas échapper à ce fond obscur qui demande à monter à la lumière de ses gestes. Le sourire d’Hélène sera déterminant[34]. Or, comme précédemment, comme lors de la formulation de la loi qui gouverne son destin : « j’aime mieux voir », l’événement se produit « dans le petit jardin de buis »[35].
Le
jardin du père
[1] Cf. Daniel Leuwers qui évoque ce goût de Jouve pour les jardins, in Jouve avant Jouve ou la naissance d’un poète, Klincksieck, 1984, p.47.
[2] Cf. par exemple comment s’enchaînent la fin du Paradis perdu (in Œuvre, tome I, édition établie par Jean Starobinski, Mercure de France, p. 74, 1987 (noté PP suivi du numéro de la page) : « Le sommeil les prend tête à tête posés/ Deux pierres appuyées au grand déserté » et le début de Les Noces (in Œuvre, tome I, op. cit., p.85. Noté NO suivi du numéro de la page.) : « Songe un peu au soleil de ta jeunesse ».
[3] Cf. Béatrice Bonhomme, Pierre Jean Jouve : la quête intérieure, Editions Aden, 2008, p.268 et 306.
[4] En miroir, in Œuvre, tome II, op. cit., p.1143. Noté dorénavant E.M. suivi du numéro de la page.
[5] Cf. EM, 1142 : « Le poète n’est pas un métaphysicien, ni un théologien ; et à la pensée du poète, l’évolution du travail commande une libre modestie. »
[6] PP, 53 : « La vérité se fait/ Se fait, une percée de funèbre lumière. »
[7] Ibid. : « elle crie, il succombe/ Sur ton démon, cloaque, ou ton bonheur ».
[8] Ibid. : « Comme ses cheveux sont des fleuves/ Et comme ses mains sont des arbres/ Et que l’ombre la couvre plus doucement qu’un poil de bête/ Et répand sur des endroits de son corps pareils à des nids/ Une odeur persuasive éveillant le hennissement ! »
[9] À ce propos cf. D. Leuwers, op. cit., p. 24 sq. et 29 sq.
[10] À propos du symbole, cf. Béatrice Bonhomme, op. cit., p. 192 sq. Pour la notion d’affect, cf. Michel Blay, Dictionnaire des concepts philosophiques, Larousse, CNRS éditions, 2006, p.13 : « forme d’action ou de passion qui constitue l’élément de base de la vie affective. »
[11] Cf. sur ces questions : Alain, Eléments de philosophie, « De l’espace », Folio essai, Gallimard, 1916/2006, p.48 ; Merleau-Ponty, Phénoménologie de la perception, « L’espace », coll. TEL, Gallimard, 1945/1976, p.306 : « […], la coexistence, qui définit en effet l’espace, n’est pas étrangère au temps, elle est l’appartenance de deux phénomènes à la même vague temporelle. », ainsi que Le visible et l’invisible et les notions d’entrelacs, de chiasme, ou de chair (coll. Tel Gallimard, 1964/997, p.178) : « On comprend alors pourquoi, à la fois nous voyons les choses elles-mêmes, en leur lieu, où elles sont, selon leur être qui est bien plus que leur être-perçu, et à la fois nous sommes éloignés d’elles de toute l’épaisseur du regard et du corps : c’est que cette distance n’est pas le contraire de cette proximité, elle est profondément accordée avec elle, elle en est synonyme. C’est que l‘épaisseur de chair entre le voyant et la chose est constitutive de sa visibilité à elle comme de sa corporéité à lui ; ce n’est pas un obstacle entre lui et elle, c’est leur moyen de communication. » ; Renaud Barbaras, Introduction à une phénoménologie de la vie, Vrin, 2008, pour les rapports entre conscience et étendue, dont p. 179 : « Ainsi, la coappartenance de la conscience et de l’étendue, loin de déboucher sur des surfaces absolues conduisant à une négation de l’intentionnalité, l’exige au contraire - ou plutôt l’intentionnalité est cette co-appartenance même. »
[12] Cf. à propos de ce personnage clé de l’œuvre de Pierre Jean Jouve, cf. Béatrice Bonhomme, op. cit., p.115 sq.
[13] In Œuvre, tome II, op. cit., p.961 sq. Noté DLAP suivi du numéro de la page.
[14] Ibid. : « Il y a dans le rapport de ces régions quelque chose d’inépuisable et de mystérieux. Il y a une qualité qui ne parvient pas à son terme. Il y a plusieurs régions étagées, enfermées dans les cent vallées bleues des montagnes creuses ou au contraire sur le piédestal de roc, de lumière et d’abstraction, tout en haut. »
[15] Cf. Laurent Lavaud, L’image, GF Flammarion, 1999, p.28 et Jean-Jacques Wunenburger, Philosophie de images, PUF, 1997/2997.
[16] Cf. l’apparition de Hélène (DLAP, 963) que Léonide définit d’abord comme un « éclatant phénomène » et qui est l’aboutissement d’une série de déplacements qui font pénétrer le personnage dans ce qui est d’emblée « un paysage peint, un tableau véritable ».
[17] Cf. cette remarque latérale dans le chapitre d’En miroir consacré au symbole et au rêve (E.M., 1145) : « J’éprouve aussi des « contrées de rêves », où les événements surviennent comme des épisodes, tandis que j’ai la certitude de me trouver dans un certain pays, bien connu, du rêve, pays où il m’est arrivé quantité de choses. »
[18] Pour cette notion, cf. Dieter Henrich, Pensée et être-soi, Leçons sur la subjectivité, trad. Martina Roesner, Vrin, 2008.
[19] À propos de ce mot, étagement, voir la définition du poète que Jouve donne dans En Miroir (E.M., p.1080) : « diseur de mots », soit « celui qui sait établir entre ces mots le potentiel d’une charge nécessaire à l’étagement de mouvements compliqués et d’épaississements graves formant la matière mentale. »
[20] Paulina 1880, in In Œuvre, op. cit., tome II, p.215. Noté P suivi du numéro de la page.
[21] DLAP, 1049 : « Car à travers cette remémoration quelque chose que je ne pouvais encore nommer commençait de naître. Par le fil de la remémoration, par le mouvement de l’amour qui y adhérait, par la puissance du tremblement de terreur et de la nostalgie l’entourant, je sentais des choses confuses se recréer, qui cherchaient un nom, des noms, qui de l’intérieur de la pensée allaient trouver leurs noms magiques et se précipiter au dehors. »
[22] In Œuvre, op. cit., tome II, p.400 sq. Noté DLD suivi du numéro de la page.
[23] Cf. mon article sur L’Italie dans l’œuvre de Pierre Jean
Jouve : la lumière des images, la figuration d’un drame métaphysique,
colloque de Saorge, 2007.
[24] Cf., le thème du Nada (E.M., 1138) à propos duquel Jouve cite ces trois vers : « Rien ne s’accomplira sinon une absence/ Dans une nuit un congédiement de clarté/ Un beauté confuse en laquelle rien n’est », et dont il dit qu’étant « une vérité intime […] une idée qui veut devenir être » et qui, ajoute-t-il, « ne peut être maniée que dans la substance, par le jeu contradictoire de l’image à l’intérieur du poème même. »
[25] Léonide parle rétrospectivement de « communications » (DLAP, 1014), mot dont le sémantisme spatial n’est pas neutre : « Je savais à présent qu’il existait en moi un démon, que c’est ce démon qui devait faire d’Hélène une expérience, et qu’entre ce démon portant partout le sexe d’Hélène, et un autre démon, celui de Pauliet, des communications devaient s’établir, une alliance allait être conclue. »
[26] Op. cit..
[27] Ibid., p.1212
[28] Ibid. : « Si je regarde assez profondément dans ce qui est en dessous de moi, mon esprit noir, dans toute une immensité toujours cachée et que les images et les idées auxquelles je suis relié par la clarté de conscience m’empêchent véritablement d’éprouver, mais qui est, qui me colore de sa lumière d’enfer, je vois se détacher sur un fond sanglant mes deux grands besoins : c’est aimer et mourir. »
[29] Cf. à propos du complexe d’Actéon, Béatrice Bonhomme, op. cit., p.180.
[30] « Je « voyais » tout, son destin redoutable, son martyre. La superbe femme était sur la prairie, tenant ses amis à distance avec le bras levé. Elle remuait un peu, plus onduleuse qu’un serpent, et ses dents éclairaient la nuit. Tout était-il donc joué, n’y avait-il plus rien à faire, pour elle, pour moi ? »
[31] Il faut bien sûr rapprocher ce passage de celui concernant l’Etranger qui ne veut que « voir » (DLAP, 1001). Cette figure allégorique nous indique combien l’association du plaisir et de la vision exile, met hors de soi, comme l’indiquait le texte de 36, La Faute.
[32] Ibid. : « Je vis un bouquet d’anémones vivantes. Je vis également une faux qui, les fleurs sorties dans la joie blanche, les tranchait et les laissait coupées à terre. »
[33] Ibid., 1015 : « …L’obsession avec les multiples images des formes, l’odeur bestiale de musc et d’humeurs secrètes imaginée, le jeu du regard qui dessine pour ainsi dire la toison d’ours et la chair emmêlées, avec les détails d’emplacement et d’aspect, et la vie que cela a, cette imagination continuelle, chaude, acharnée, devenue aiguë jusqu’à la douleur et agréable au point de provoquer des larmes, j’étais bien incapable de m’en défaire ; mais avec Pauliet je la refoulais continuellement afin qu’il lui fût impossible de rien en voir ; ce que je demandais à Pauliet, ce que je voulais tirer de lui, je le reprendrais ensuite à partir de mon monde formé de ces images-là, je le joindrais à moi – pour (si possible) y arriver. »
[34] Ibid., : « J’avais voulu prendre une autre route, une route à moi, contre Pauliet ; je le voulais encore ; mais un événement comme le sourire que je venais de recevoir, avait tout de suite des conséquences bien graves, en engendrant le désarroi. »
[35] Ibid., 1014 : « Je n’avais jamais vu sourire… Je voyais pour la première fois un sourire. J’ouvrais dans la figure la porte qui donnait sur l’être intérieur./ Hélène me sourit de ce sourire qui s’ignore, plusieurs minutes durant, dans le petit jardin de buis. Elle força de rester immobile et de la regarder sourire. »
[36] « Retour chez Hélène », Proses, in Œuvre , tome II, op. cit., p.1195.
[37] Les Noces, in Œuvre , tome I, op. cit., p.129.
[38] « Au monde », ibid. p.133 : «
[39] « Jalousie », ibid., p.132 : «
[40] Ibid., p.140 : « .
[41] « Glorieux âge », ibid., p.141 : «
[42] In Oeuvre tome I,, op. cit., p.1625. Noté dorénavant E suivi du numéro de la page.


Retour à la Page d'Accueil du Site
Site Pierre Jean Jouve
Sous la Responsabilité de Béatrice Bonhomme et Jean-Paul Louis-Lambert
Ce texte © Éric Dazzan
Dernière mise à jour : 25 Juillet 2009