
|
Lectures
de
Pierre
Jean Jouve
|
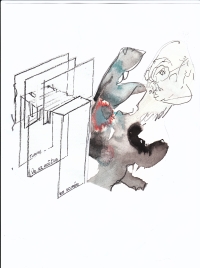
Retour à la page d'Accueil de la rubrique Lectures de Pierre Jean Jouve
Narcisse au jardin :
Une lecture de Artificielpar Éric Dazzan
Daniel Leuwers[1] relève à propos d’Artificiel que si la maîtrise de l’auteur « y est sans reproche », cependant « la faille […] réside peut-être en ce que les poèmes jouviens ne sont pas suffisamment nourris par une expérience vécue. » Cette expérience, Jouve ira la chercher soit dans l’érotisme – et il s’agit de la rencontre de Lisbé et de ses développements ultérieurs[2] – soit dans son adhésion à l’unanimisme puis dans son engagement pacifiste[3]. Pour l’heure, la production du jeune Pierre Jean Jouve s’est enfermée dans « l’idéalisme d’un des Esseintes », c’est-à-dire aussi dans un monde d’images et d’influences littéraires[4]. Et c’est dans ce monde livresque et à première vue comme à vide que se dessinent certaines tendances, ou encore que s’esquissent dans une langue dont la musicalité est très mallarméenne et très décadente certains mouvements inconscients que l’on peut considérer comme autant de matrices de l’œuvre à venir.
Mais cette opposition entre « l’expérience vécue » et l’idéalisme – ou la position idéaliste d’un Des Esseintes – ne va peut-être pas de soi lorsqu’on aborde l’œuvre de Pierre Jean Jouve. L’enfermement dans un monde d’images (de représentations) et l’idéalisme qui lui correspond ne sont d’ailleurs peut-être pas tant des maladresses de jeunesse que les signes déjà d’une tendance profonde de l’imaginaire jouvien. Une œuvre comme Paulina en témoignera bien plus tard. Les images y jouent en effet un rôle déterminant dans la mesure où elles permettent au personnage principal de prendre conscience de son corps et de ses désirs et ainsi d’entrer en relation désirante avec le divin[5]. Elles sont en quelque manière le chemin par lequel une expérience de soi et de l’autre devient possible et trouve à se vivre. Il y a donc un idéalisme foncier au cœur de l’œuvre de Pierre Jean Jouve dans le sens où le personnage jouvien est d’abord dans un monde de représentations dont le centre est une subjectivité en quête d’elle-même. Mais cet idéalisme n’est pas négation du réel en tant qu’il se différencie de sa représentation et qu’il reste possible d’en faire l’expérience. Il procède plutôt de l’intuition d’une profondeur qui fait signifier le réel et qui est d’abord relation du sujet à ce qui est tout autre que le sujet. Si le monde jouvien est un monde de représentations, c’est parce qu’en elles et à travers elles le sujet jouvien s’avance vers ce qui n’est pas lui et n’est pas non plus le réel (quoiqu’on puisse dans un premier temps le confondre avec lui). Et cheminer vers cet au-delà demande que la dimension la plus charnelle de notre présence au monde soit mise en jeu et dépassée. L’acte sexuel est alors le lieu où s’éprouvera de manière décisive un au-delà du sujet et du réel. La profondeur qui s’y découvre peut bien sûr valoir pour abîme et néant et les mots auront alors à charge de les faire résonner de leur musique. Mais elle est aussi l’horizon ou le fond sur lequel se détachent un destin et une identité, c’est-à-dire se manifeste une aptitude à se différencier, à se clore sur une identité et une différence et ainsi à entrer en relation avec ce qui est autre ou l’Autre. Que cette différenciation, cette affirmation d’un soi ou d’un propre et la relation à l’altérité qu’elle autorise ne puissent se faire qu’en regard du néant sur lequel elles se découpent, permet peut-être de comprendre pourquoi cette œuvre est hantée par les différentes formes que peut prendre la négation du moi, que ce soit le renoncement qui marque la fin de Paulina ou encore le suicide, celui de Jacques ou celui de Gribouille. L’on pourrait avoir ainsi l’impression qu’il s’agit là d’un retour à un état d’indifférenciation, ou de non différenciation avec ce qui est apparu tout à la fois comme le plus fascinant et le plus redoutable. Et dans ce cas l’on pourrait hésiter entre les figures maternelles et paternelles. Dans le cas de Gribouille la noirceur de l’eau dans laquelle il se jette et la voix qui en monte, tendre, pourrait aussi bien valoir pour l’une comme pour l’autre[6]. Il suffit de relire le début d’Enfance pour donner toute sa valeur à cette noirceur de l’eau. Quant à Jacques, son suicide se donne comme une tentative de rejoindre le père mais il ne peut non plus être séparé de l’image qui lui apparaît dans l’eau, image féminine, liée à son père par la généalogie. Comme le montrent bien des personnages de l’œuvre de Pierre Jean Jouve, l’être-soi ne peut vraiment s’éprouver que dans la relation à ce qui le nie, éveille en lui un désir – foncièrement incestueux – de fusion avec l’autre et d’anéantissement de soi dans l’autre.
L’œuvre de jeunesse qu’est Artificiel ne fait bien sûr qu’indiquer ces tendances. Je me propose dans les lignes qui suivent d’en relever et analyser certains éléments et de le faire à partir du motif du jardin et de l’enclos qui supposent la clôture – condition de l’identité – et drainent, du moins pour le premier motif, un imaginaire que l’œuvre à venir fera sien.
Un
néant musicien
Le motif du jardin apparaît assez rapidement dans Artificiel, dans ces « essais de sensibilité » comme les nomme la dédicace aux amis des Bandeaux d’or[7]. On le rencontre à la fin du premier ensemble, « Mémoires » (ART, 1328), plus précisément dans les deux derniers poèmes où sont évoqués « ce jardin d’Automne aux grands nuages » et « ce Jardin mouillé », l’un et l’autre associés à l’âme de l’interlocuteur lyrique : « …ton âme, en ce jardin » et « O ton âme…/ ton âme à jamais seule en ce Jardin mouillé ». Nous sommes là, à première vue, dans un jardin typiquement symboliste. Nous y (re)trouvons, en effet, les vasques, le jet d’eau, la pluie, les allées, la mort ainsi que le vieillissement, la musique et le silence, etc., le tout formant un paysage intérieur lié à la mémoire et au souvenir[8] et qui est, en définitive, assez attendu. Ces deux jardins sont des sortes de transpositions sonores et figuratives d’un état d’âme marqué par la déréliction[9]. Il faut toutefois s’étonner de la majuscule que porte le jardin de la dernière strophe du dernier poème. Dans l’avant-dernier poème, cette majuscule était accordée à l’automne. L’on pourrait avoir le sentiment que d’une mention à l’autre, le moment se fait lieu et que s’ouvre ou s’inaugure ainsi une sorte de figement éternel, a-temporel dans le mourir, l’agonie solitaire[10]. D’où bien sûr une tendance, là encore assez attendue, à l’effacement ou à l’évanescence, toute la présence de ce qui s’efface se concentrant dans les fractures, heurts rythmiques assez mallarméens[11] ou les silences que figure l’aposiopèse. La fin de « Mémoires » réalise donc en quelque façon le « programme » que l’on peut lire dans le poème de Mallarmé cité en épigraphe (ART, 1324). Un site qui « a bien été » cependant se déréalise dans l’absence de citation par « L’or de la trompette d’été » ou du fait de son effacement dans la lumière[12]. Et dans cette absence de nomination résonne de tout son silence un non-dit qui deviendra plus tard un secret. Reste donc dans ce néant d’automne les mouvements de la sensibilité qui disent l’être dans son évanescence et ses accès de fièvre, mouvements qui oscillent entre la danse[13] et le dandinement[14], l’adhésion et la distance. Ce « paysage horizontal du silence sous la pluie » (ART, 1327) n’est donc pas destiné à exister puisqu’il est chargé de dire le sentiment d’inexistence. Il n’est d’ailleurs pas composé à proprement parler comme un paysage, en ce sens qu’il est non seulement sans structure mais aussi sans limite, sans les murs et les portes – et les voisinages qu’ils induisent – qui seront essentiels par la suite au jardin jouvien.
L’enclos :
identité et clôture
Si le jardin qui ouvre le poème intitulé « La lune » (ART, 1329) trouve au contraire d’emblée sa forme : « Vois le jardin carré », ainsi que son voisinage : « C’est au bord de la lune » (ibid.), il est cependant dévoré de trop de blancheur, d’extase et de silence pour parvenir à former une image qui donne effectivement à voir autre chose qu’une inscription symboliste, un geste poétique qui, encore une fois, survit à peine dans la trace musicale qu’il abandonne sur la blancheur de la page. Son titre, ou son motif, induit bien sûr cette évanescence mais contrairement aux derniers poèmes de « Mémoires » aucune fracture ou secret cette fois, aucune expression qui soit l’équivalent de cette « eau poisseuse qui dort » (ART, 1328) et qui laissait résonner comme un avant-goût du ton jouvien à venir.
« L’enclos »
(ART, 1331) qui apparaît dans « L’Avril » semble ne contenir lui
aussi guère plus que sa musicalité recherchée. Pour autant, il me semble
nécessaire de s’attarder sur ce poème au titre tellement convenu. Si
« l’enclos » ne désigne pas à proprement parler un jardin, cependant
sa mention à deux reprises dans le poème souligne fortement un élément qui
était apparu avec le « jardin carré » du poème précédent : la
clôture. Or qui dit clôture, dit différenciation entre un dedans et un dehors
et bien sûr leur possible relation au sein d’une totalité qui se structure en
un haut (l’azur) et un bas (la terre) et qui s’ouvre sur une temporalité et un
ad-venir. « L’Avril », aussi convenu soit son matériau, se
différencie en effet des poèmes qui le précèdent en ceci qu’il organise (plus
largement ou plus nettement) les éléments d’un paysage – parmi lesquels
l’enclos – et qu’en ce paysage s’ébauche un récit qui met en scène un je et un personnage féminin qui est
désigné par le pronom elle. Le
présent a-temporel qui caractérise les premiers poèmes s’ouvre ainsi sur un
horizon qui est marqué par la mort : « Car il faudra qu’elle me meure
à l’été/ sur la mousse douce d’un autre jour:/ et l’azur sera vert et pâle
toujours, autour/ de cette pierre où vit sa robe reposée » (ibid.). L’enclos est potentiellement (et
sans surprise) celui des morts (sinon des jeunes mortes) et cette mort annoncée
advient en quelque manière, comme l’indique le datif éthique, aussi bien au
personnage féminin qu’au je (bien sûr
selon des modalités différentes). Bien plus, l’on peut constater, si l’on
replace cette strophe dans l’ensemble du poème[15],
que la relation du je au elle ne se dit (s’explicite) qu’au
moment où s’annonce la mort à venir. Et de ce fait l’on pourrait se demander si
la mort n’est pas le fond sur lequel advient et s’inscrit nécessairement la
relation elle-même. Le dernier vers qui encadre le verbe vivre par le
substantif pierre (et l’on pourrait
bien sûr songer au premier prénom du poète) et le verbe reposer (au participe passé, forme de l’accompli), pourrait
confirmer le sentiment que la mort enclôt de son immobilité la vie et les
mouvements qui l’ont signifiée tout au long du poème. Enfin, que le personnage
féminin ait à mourir au je pourrait nous amener à entendre cette
mort dans son parallèle possible avec la possession ou du moins comme ce qui
révèle et fait advenir cette possession. L’on pourrait voir là comme une
matrice, à peine esquissée et en attente d’être exploitée et surtout de
s’enraciner dans une expérience, d’un élément à venir de la
« pensée »[16]
de Pierre Jean Jouve. Sans aller si loin, il nous faut tout de même relever que
cette dynamique particulière de la relation entre le je et le elle, telle que
l’esquisse cette dernière strophe, s’inscrit dans une dynamique d’ensemble qui
caractérise le paysage en lequel ou à travers lequel apparaît, comme en
surimpression, un personnage féminin dont il recevra sa véritable signification.
Comme nous allons le voir, il est difficile de ne pas songer à la manière dont
Hélène apparaît, « éclatant phénomène », véritable émanation du
paysage, précédée même de son haleine, de ce « souffle chaleureux et
tendre » qui semble « l’émanation d’une chair »[17]
et qui dans « L’Avril » n’est encore qu’un « vent de pastel
tiède et de verdeur et de couleur » (ART, 1331).
Ce poème organise, en effet, une sorte de relation- circulation entre les éléments du paysage et il le fait à partir de motifs qui sont appelés à de fécondes métamorphoses dans l’œuvre à venir. Le premier motif est celui des yeux : « Au yeux des primevères, les gazons, l’enclos/ où le paon du Printemps ourlé/ se reverdit des taches de l’eau… » Les yeux sont bien sûr en rapport d’analogie avec le motif de l’eau et du reflet qu’elle supporte, rapport d’analogie que l’on trouve exploité dans la strophe quatre : « Entre les cils, les vagues distantes/ du fleuve tremblent comme un rire, luisantes/ au vent de pastel tiède et de verdeur et de couleur. » Ainsi semble circuler d’un œil à l’autre et /ou d’une eau à l’autre le reflet du monde, chaque chose venant peut-être à la présence aux yeux des autres, image-reflet signalant une distance tout autant qu’une présence. Mais les yeux sont bien plus chez Jouve que le regard[18] – le poème précédent commençait par l’impératif vois[19] – ils sont plus essentiellement ouverture et de ce fait potentiellement en analogie avec la bouche et le sexe féminin, liant très intimement à la sexualité le regard ainsi que l’âme sur laquelle il ouvre ou à laquelle il accède. De nombreux poèmes de Sueur de sang[20] en témoigneront plus tard et bien sûr le personnage d’Hélène. Dans « L’Avril » cette valeur sexuelle des yeux et du regard n’apparaît que dans les strophes trois et quatre. En effet, ce qui a été caractérisé comme (en)clos – c’est-à-dire délimité - nous est donné par la suite comme ouvert, sinon entrouvert. Le montre la place stratégique qu’occupe la préposition entre dans les strophes trois et quatre du poème dans lesquelles par ailleurs se superposent les motifs de l’œil et de la bouche :
Et une
tiédeur de soie, d’entre l’enclos
monte au
nuage, constellée,
fragile fumée
entre les
rives des bouleaux.
Entre les
cils, les vagues distantes
du fleuve
tremblent comme un rire, luisantes
au vent de
pastel tiède et de verdeur et de couleur.
Le rapprochement entre l’œil et la bouche[21] était inscrit dès la première strophe par l’emploi du qualificatif ourlé qui apparaît dans le deuxième vers. Il peut bien sûr annoncer les vagues de la strophe quatre. On peut aussi se souvenir qu’employé absolument, il se dit également des lèvres au contour renflé, pulpeuses. On pourrait avoir l’impression qu’un personnage féminin, un peu à la manière du Balzac du début du Lys dans la vallée, apparaît comme en surimpression ou plutôt que certains éléments en sont dispersés dans le paysage qui en reçoit sa signification : l’œil, la bouche, et la robe qui enclôt le corps et qui (comme l’enclos) est nommée à deux reprises dans le poème. Nous avons vu comment la dernière occurrence la liait à la mort et à son immobilité de pierre. À l’inverse, la première de ces occurrences la lie semble-t-il aux nuages, à l’azur ainsi qu’au mouvement. Quant à la présence charnelle vers laquelle elle fait signe, elle se réduit peut-être à ce qui est respiré : « Des nuages je respire ce que j’aime,/ à l’azur gonflant sa robe de ses gemmes ». C’est cette allusion qui est peut-être potentialisée dans l’expression qui ouvre la troisième strophe : « Et la tiédeur de soie », et dans laquelle on retrouve aussi bien un élément de la robe que du corps. Une « tiédeur de soie » qui deviendra « fragile fumée » et peut-être fumet d’amour[22], odeur d’intimité comme l’indique le tout début du poème intitulé « Sonnet »[23]. La tiédeur se communiquera par la suite au « vent de pastel », imprégnant l’image de corporéité – mais aussi renvoyant le corps à un statut ou à un devenir potentiel d’image. Quant à la soie, terme qui revient si souvent dans le recueil, l’on pourrait être tenté de l’entendre musicalement et, dans une perspective symboliste, d’y reconnaître tout autant le tissu que le terme qui désigne le propre de chaque individu, ce en quoi chaque individu se différencie. Ainsi le syntagme « tiédeur de soie », associant potentiellement le corporel et l’essence de l’individu, laisse deviner ce lieu où se mêlent le propre de l’individu et la sexualité, un lieu où l’être féminin s’appartient (et se reconnaît) en tant que lui-même et où il se donne en son essence[24]. Ainsi ce qui s’organise (s’esquisse), musicalement et allégoriquement ou symboliquement dans ce paysage, c’est une sorte de disposition générale à l’amour qui dans Artificiel n’est pas encore liée au péché mais qui suppose le double mouvement qui y dispose, à savoir une individuation et une sexuation, une individuation comme sexuation, manifestation de la sexualité. Là encore l’on pourrait songer à l’œuvre ultérieure et plus précisément au Paradis perdu[25] qui associe fortement les deux phénomènes, qui en dit la concomitance dans l’évolution du personnage de Satan (PP, 19 et 21) puis d’Eve qui est nommée dans l’instant où elle est prisonnière de la Faute et disposée à accueillir le Serpent, à disjoindre « ses cuisses » (ibid., 51). Que l’horizon de la manifestation de ce personnage féminin dans le paysage soit la mort confirme le fait que nous avons peut-être dans ce poème de jeunesse comme la matrice d’un imaginaire qui trouvera à se déployer par la suite et qui demeurera en attente d’une expérience qui puise la potentialiser.
Finalement, et pour revenir à la musicalité des poèmes de ce recueil de jeunesse, l’on peut constater que si elle pouvait s’entendre d’abord comme trace d’une présence au bord de l’effacement, au fil du recueil, elle s’alourdit d’une charge fantasmatique qui déborde progressivement l’imagerie symboliste. D’où peut-être ce sentiment qu’une combinatoire qui met en jeu des motifs assez convenus – la pluie, la blancheur, la fontaine, l’or, etc. – perd en gratuité ou plutôt tente de gagner sur le non dit, l’indicible et s’approche de l’aveu qui dans sa brutalité fait encore entendre toute la chaîne symbolique (et musicale) qui l’a anticipé secrètement. En témoignent les derniers des « Vers pour une décoration » (ART., 1344) dans lesquels reviennent le motif du regard que le rythme identifie ou superpose à une idée, au sens premier d’image comme si regarder était moins saisir un corps dans son évidence ou sa monstration provocante que le dépasser en direction d’une image qui pourrait en donner à voir le propre. D’où l’apparition du motif de l’ouver(ture), mot qui laisse entendre aussi bien le ourlé du Printemps de « Avril », que le vert qui caractérisait l’azur dans le même poème et qui se déclinera dans le même vers en ovaire[26] : « pour un seul regard, une idée : / le meuble grand ouvert d’ovaire. » Même si ce travail ne se fait pas directement en association avec le motif du jardin, il est significatif qu’il trouve à se « cristalliser » dans un poème comme « Avril » qui place au centre de son paysage l’enclos. L’enclos et le jardin jouvien en héritera, vaut pour sa clôture qui lui donne une forme ainsi que pour l’ouverture potentielle sur un dehors qui résulte de cette clôture. Il vaut donc par son potentiel de différenciation ou comme le signe d’une différenciation. Mais il vaut aussi par l’échange – au sens de commerce mais aussi de substitution et ou de jeu de miroir – que cette différenciation rend possible. On peut d’ailleurs se demander si avec lui n’est pas mis en jeu une caractéristique fondamentale du sujet jouvien que la fusion menace – et le motif de la noyade dans cette oeuvre est récurrent – et qui en même temps la recherche ou la réclame. En effet, ce qui est enclos ainsi dans le jardin lequel devient potentiellement et indistinctement œil, bouche et sexe, c’est la possibilité même d’une altérité (sexuelle), c’est une altérité qui posée et prenant forme dans une clôture permet à un sujet de se (s’en) différencier. Mais c’est aussi la menace que représente la fusion-confusion qui prend forme et face à laquelle le sujet vient à l’existence : se séparant de ce qui le menace et existant par cette séparation, il fait exister cela même où il tend à s’anéantir et se voue à exister dans la fascination de ce qui le menace. Nous allons retrouver tous ces éléments dans « Traditions intimes » qui clôt Artificiel et qui convoque sur la scène érotique la tension entre la fusion et la différenciation, comme le fera bien plus tard et selon des modalités différentes et avec une ampleur et une maîtrise tout autres, Le Paradis perdu[27].
Un
jardin de mémoire : narcissisme et image
Point de jardin dans cette section, sinon qu’elle s’ouvre par une épigraphe empruntée à Remy de Gourmont, un fragment de dialogue entre Lilith et Satan dont la teneur érotique est explicite. Il est difficile de ne pas remarquer que cette épigraphe semble anticiper sur Le Paradis perdu. Les quatre répliques que Jouve a retenues inscrivent en effet la sexualité dans la tension entre des images qui l’associent au printemps (à « L’Avril ») : « Satan : Je humerai ton sexe comme un bouquet de lilas/ Lilith : Je donnerai la becquée à ton sexe comme à un petit oiseau », et l’ombre qui fait signe vers un avenir de faute et d’inconscient : « Satan : Mon univers est là, sous cette ombre ». C’est la même ombre[28], lieu du secret et lieu secret (inavouable), qui définira bien plus tard dans le Paradis perdu « l’Arbre/ Arbre-de-la-Connaissance-du-bien-et-du-mal », que le texte décrit comme « Un grand concert de bras et d’ombre avec le vent/ Une grosse boule admirable ou un autre Eden » (PP, 38). Cet univers qu’est le sexe de Lilith (et que sera plus tard celui de la femme) est celui de Satan parce qu’en lui l’homme se connaît, connaît sa faute et, comme le dit le texte qui accompagnait la première édition de l’ouvrage, connaît qu’il la désire et y prend plaisir[29]. Cette connaissance est aussi prison, clôture dans un univers qui mêle indéfectiblement le plaisir et le savoir, un savoir dont le corps tout autant que la conscience est le lieu[30]. Cet autre jardin, cet autre Eden obscur qu’est le sexe de la femme est un jardin de délices et d’inquiétudes et comme le laisse entendre le premier poème de « Traditions intimes » (ART, 1346), il est un lieu « d’asphyxie inquiète » [31] et d’enfermement dans le mal, ainsi que dans le néant qui l’accompagne et qui est d’abord celui des mots et des images.
De quoi nous parle, en effet, « Traditions intimes » ? À première lecture, les poèmes qui composent l’ensemble semblent évoquer des pratiques d’onanisme[32]. Le mot traditions dans cette perspective doit être pris dans son sens le plus faible : ce qui est évoqué recouvre tout au plus des pratiques qui sont aussi anciennes que la pratique sexuelle des sujets eux-mêmes. Et l’adjectif intimes s’entend simplement dans son rapport à la sexualité en général et de l’onanisme en particulier qui sont affaires d’intimité, de vie privée. Il s’agit donc de pratiques qui ressortent de l’intimité et qui en créent entre les êtres[33]. Mais l’on peut aussi, et sans contradiction avec ce qui précède, prendre le mot tradition dans son sens fort et considérer qu’il renvoie à ce qui se transmet et vient de plus loin que le sujet qui l’hérite, de plus (mythiquement) originel donc. Dans cette perspective l’intimité dont ressortent ces traditions est bien plus que la sphère privée, elle regarde l’intime du sujet, ce qui le définit en propre à la fois comme sujet et, comme il s’agit de tradition, dans son appartenance à un groupe (ici l’espèce humaine). Le contexte général (et l’apparition du serpent dès le deuxième poème) – ainsi que l’avenir de l’œuvre – nous incitent bien sûr à songer au péché originel, à cette faute pour laquelle l’homme fut chassé du Paradis et qui est indéfectiblement liée à la sexualité et à la mort, à la sexualité en tant qu’elle est liée très intimement à la mort et, plus précisément, qu’elle est, en tant qu’action, le lieu même où s’accomplit et se revendique la conscience de la mort. C’est bien ce que mettra en scène le texte du Paradis perdu intitulé « Premier amour » (PP, 50), « la blessure inavouable » qui va ouvrir en Eve la voie du sexe aura d’abord été reçue en conscience, dans le savoir d’une irréversibilité avant d’être agie et traduite dans la liberté provocante d’un corps qui s’expose[34]. Or ce qui est le propre de cette « blessure inavouable » et du mal qui lui correspond, c’est de se propager, c’est leur rémanence, le fait qu’ils envahissent de passé, de mémoire et de souvenirs le présent et l’avenir. Le dira le poème suivant du Paradis perdu, intitulé « Elle revient ». Lorsqu’« elle revient », en effet, vers Adam, alors que le grand Arbre et l’autre jardin sont « très loin » (PP, 52), le texte nous dit qu’Eve « marche au fond de sa propre mémoire » et plus loin, qu’elle « voudrait recommencer dans sa mémoire ». La mort qu’accomplit l’acte sexuel originel n’est pas que basculement dans le temps, et acquisition d’un savoir, elle est aussi basculement dans les signes et leur pouvoir d’anéantissement, c’est-à-dire à la fois de répétition et de creusement, d’évidement de toute présence. Ainsi Le Paradis perdu fait-il se suivre le « Premier amour » avec le Serpent, et l’acte sexuel avec Adam dans lequel ce qui eut lieu une première fois se répète et s’ensauvage et ainsi s’achemine vers son sens[35].
Cette « situation » qui est celle de l’homme dans le monde d’après la Faute est déjà en germe dans « Traditions intimes », l’acte d’écriture ayant pour fonction, comme on va le voir, d’y renouveler le geste qui conduit du plaisir au néant, à la conscience comme redoublement de l’anéantissement originel[36]. L’on pourrait comprendre ainsi le rapport de l’épigraphe aux poèmes qui vont suivre, la première n’étant pas seulement une clé de lecture des seconds mais faisant de l’histoire qu’ils évoquent le reflet ou l’écho d’un drame originel, et ouvrant pour les « personnages » qu’ils mettent en scène un espace qui tient à la fois de l’incarnation et de l’image. C’est dans cette perspective encore d’une histoire humaine qui n’est que redoublement, approfondissement d’une origine et qui ne connaît de présent que traversé de passé sinon comme recommencement du passé, qu’il faut entendre le motif de l’odeur qui apparaît dès le premier poème. Comme le parfum baudelairien ou plus tard dans le poème intitulé « L’Arbre mortel » qui fait écho à l’autre Eden du Paradis perdu (NO, 99), le parfum est lié à la mémoire, investit le présent d’un passé qu’il ressuscite[37] :
Au premier
jour d’une année rose
je ressuscite
le benjoin,
le sein d’une
obscénité close,
sublimé, mon
amour, des suints.
Je reviens en
odeur ouverte
à son pollen
d’âme, gluant
un anneau
d’asphyxie inquiète
aux accords
mous de langue lents
Et te dédie
ce vers tremblant.
(ART, 1346).
L’on pourrait avoir le sentiment que s’investit de nouveau dans ce poème la chaîne à la fois symbolique et sonore que nous avions relevée dans « L’Avril », signe d’une fascination où se joue la possibilité d’une différenciation (des sexes, des êtres). D’où cette tension entre le clos et l’ouvert, la rémanence du [èr] et du [o] qui émiette une obsession. Que l’odeur soit préférée au parfum plus baudelairien pourrait peut-être ainsi s’expliquer tout autant par son inscription dans cette chaîne symbolique et sonore que par sa valeur plus immédiatement charnelle.
Par l’odeur le sujet – qui plus loin se définit comme « maître d’un parfum moins las » (ibid., 1348) - pénètre dans un monde intérieur, un monde d’images ou en lequel le présent bascule infiniment dans l’image et dans lequel va se jouer et son rapport à l’autre - qui est Sphynge[38] - et sa propre identité (sexuelle). Ressusciter le benjoin, signifie ici réveiller tout un monde de souvenirs et probablement le faire à travers les allusions littéraires qui, au-delà du jeu précieux, ont peut-être également pour fonction d’épuiser ce qu’il reste de réel dans ces souvenirs. Cette dimension de remémoration, nous la trouvons marquée dans la série de poèmes par l’emploi ponctuel de verbes au passé simple qui dessinent, esquissent plutôt un récit qui reste lacunaire et qui vient comme nourrir de réalité ce qui d’emblée nous est donné comme une rêverie onaniste dont on comprendra dans le tout dernier poème qu’elle trouve son moteur dans la remémoration d’une (autre) scène d’onanisme. Les deux poèmes qui ouvrent et ferment l’ensemble sont donc comme « en miroir » l’un de l’autre. Cette structure en miroir se déploie à partir d’un présent d’écriture – qui possède également une valeur itérative potentielle – et en direction d’une scène contemplée ou retrouvée en esprit, scène à laquelle le participe présent et l’imparfait de la dernière strophe confèrent l’immobilité qui est propre au tableau :
Vous, c’était
tout un printemps blanc
Du souple
éclat que vous meniez
Entre vos
doigts adolescents
Mignarde de
vous polluer.
Le pourpre
caillot du manteau
tombant dans
la lune arrondie,
suavement
comme un étau
semblait rire
de minutie.
Cet effet de clôture dans le reflet et l’image qui se reflète infiniment dans le miroir de l’esprit ou de la mémoire est souligné par l’écho à la fois sonore et sémantique entre l’« anneau d’asphyxie inquiète » du premier poème et l’« étau » du dernier. L’on pourrait également, dans la perspective de l’analyse de « L’Avril » relever aussi bien l’assonance insistante en [o] que l’apparition fugace du rire et avec lui de la bouche. Retour et clôture, ou encore clôture dans le retour au même des images, dans ce « pollen d’âme » qui féconde la rêverie et la fait se perpétuer indéfiniment définissent cet instant qu’évoque le premier poème. Et dans cette clôture onaniste dans les images, il s’agit bien de rouvrir fantasmatiquement cette « obscénité close »[39] qui exhibe son secret et sa clôture (sur son secret) comme une provocation et un signe de mauvaise augure. Un poème ultérieur de Les Aéroplanes[40] établira une analogie entre la mémoire du corps et le sexe des femmes « après l’amour » :
Comme après
l’ivresse du vin, je rentre en moi,
En moi qui
porte mes bras et pousse mon corps
Dont la
mémoire se referme dans la joie
Comme le sexe d’une femme après l’amour.
L’écriture de « Traditions intimes » qui se donne d’emblée comme acte de résurrection du passé et comme acte de masturbation vise à libérer ce potentiel de mémoire et d’images qu’enclôt cette obscénité, elle-même image qui ne dit pas son nom mais vers laquelle le sujet revient, s’enfermant ainsi dans un destin de faute et de péché[41]. A cette (double) clôture mauvaise (sur un secret et dans les images) Le jardin des âmes (NO, 140) opposera bien plus tard un jardin dont les « parois [sont] clôturées par les anges » et qui est clos sur « la mémoire/ Du supplice d’un Dieu », image pieuse de la Passion du Christ qui suffira à garder clos « le sexe de l’épouse » (Ibid., 132), à l’abstraire même de la réalité charnelle, de cette « exacte veilleuse » (ART, 1347) nous dit un poème de « Traditions intimes » ou encore à l’enclore dans l’image très pure de « la rose/ dans un verre bleu entouré de larmes » (NO, 1347) et dont on peut suppose qu’elle n’est pas destinée à éclore.
Pour l’heure, dans « Traditions intimes », le jeune Pierre Jean Jouve dit la puissance d’attraction (et de blessure) de ce qui comme l’autre Eden du Paradis perdu renferme en son ombre une lumière imaginée, remémorée ou encore (PP, 38) un bruissement de « rumeurs étouffées que l’on écoute/ en rampant », se faisant déjà serpent ou bien « anneau d’asphyxie inquiète/ aux accords mous de langue lents » (ART, 1346). Et il faut prendre à la lettre le substantif saint dans le syntagme « le saint d’une obscénité close ». Ce qui est en jeu ici a bien à voir avec le sacré et forcément avec l’impur et donc avec sa sublimation et plus précisément avec sa dissémination musicale. Mais ici sublimation et dissémination musicale n’abstraient du réel que pour potentialiser une puissance érotique qui est puissance de contamination de la jouissance solitaire. Il faudra attendre la seconde période de l’œuvre pour que cette potentialisation, cette sublimation musicale de la chair trouve une orientation qui fasse de l’enferment dans le néant et les images qui le hantent (sinon le définissent) l’issue vers une libération, à la fois l’approfondissement de la faute et son dépassement. La parole musicienne[42] que devra devenir la poésie jouvienne, dans « Traditions intimes », ne semble pas avoir trouvé la polarité bien mal qui lui donnera plus tard son dynamisme propre. L’ensemble s’en tient à la provocation et à l’expression de la fascination, mettant en scène la puissance érotique de l’acte d’écrire – d’« une langue musicienne » - qui dans les deux premiers poèmes équivoque avec l’acte sexuel (de la fellation). Ecrire, rêver, c’est gluer, engendrer, en son retour imaginaire (fantasmatique) ce qui nous est donné dans le premier poème comme « une anneau d’asphyxie inquiète/ aux accords mous de langue lents » et encore comme « ce vers tremblant ». L’un et l’autre deviendront dans le poème suivant bouche et serpent, et l’acte sexuel conservera sa parenté analogique avec la musique et la parole à travers l’équivoque du mot langue.
Le fait que cet « anneau d’asphyxie inquiète » que glue la rêverie fasse écho à l’année (rose qui rime malicieusement avec close) nous indique que cette obscénité close ne s’ouvre (n’éclôt) que pour redoubler une enfermement qui n’est peut-être pas qu’enfermement dans les signes et les images déréalisées mais aussi peut-être dans un type d’image marquée par le narcissisme dans lesquelles se brouille la différenciation sexuelle. De fait, si l’on considère que le je qui dans le premier poème dédie à un tu « ce vers tremblant » renvoie à la figure du poète et si l’on constate que dans la première strophe s’effectue une sorte de partage du féminin (l’obscénité close) et du masculin (le benjoin, le saint, sublimé, les suints), ce partage se brouille dans la deuxième strophe : « Je reviens en odeur ouverte/ à son pollen d’âme, gluant/ un anneau d’asphyxie inquiète/ aux accords mous de langue lents. » D’une part le je qui fait retour semble prendre en charge les caractéristiques du féminin (passage du masculin de benjoin au féminin d’odeur, l’ouverture, la possibilité d’engendrer). D’autre part, si anneau est masculin, il renvoie à la bouche qu’évoque le poème suivant, bouche que l’on ne sera pas surpris de voir dans le poème suivant s’ouvrir et dispenser une ombre dans laquelle la langue (féminin) devient serpent (masculin) :
La pulpe de
sa bouche ombrant
une langue
musicienne,
la rouge
volute descend
l’or en
salive de ma scène.
Quand le
serpent d’une heure lourd
lève une à
une les écailles
tout le blanc
clavier, comme pour
jouer
l’instrument des corails
(ART, 1346).
Non seulement, le dénudement de l’énigme (ART, 1348) auquel donne lieu la rêverie recouvre peut-être une angoisse somme toute assez classique de castration et dans cette perspective la dédicataire du « ver(s) tremblant » est bien Sphynge mais cette première menace en recèle une autre, plus radicale peut-être, celle de la confusion des sexes que dit l’androgynie (dont on ne peut dire, dans la strophe qui la mentionne, et du fait une ambiguïté de construction, si elle est le fait du tu ou du je ou des deux) :
Sphynge
dénudant de l’énigme
la lascive
mobilité,
je complais à
tes dieux intimes,
androgyne de
leur été.
[1] Jouve avant Jouve ou la naissance d’un poète, Klincksieck, 1984, p.45.
[2] Cf. « Sous le signe de Lisbé », ibid., p.46 sq. ainsi que Béatrice Bonhomme, Pierre Jean Jouve, « Eros et Thanatos en un seul acte : Le mythe d’Hélène », Aden, 2008, p.115 sq.
[3] Cf. Daniel Leuwers, op. cit., p.62 sq et p.97 sq. Notons que dans les deux cas il s’agit aussi d’une quête de la figure paternelle.
[4] Ibid., p.45.
[5] Pour la question de l’image et sa fonction dans la constitution du rapport à soi, l’on peut se rapporter à la théorie de Lacan (dont on connaît la proximité avec Blanche Reverchon) du stade du miroir (in Ecrits, Seuil, 1966). Cf. l’analyse qu’en donne Pascale Gillot dans « Entre science et idéologie : Louis Althusser et la question du sujet », in Le concept, le sujet et la science, P. Cassou-Noguès et P. Gillot (éd.), Vrin, 2009, p.155.
[6] In Œuvre, tome II, édition établie par Jean Starobinski, Mercure de France, 1987, p.874: « Car à l’endroit du passage il n’y avait pas de réverbère et de plus c’était très profond. Et de la surface noire justement montait une voix qui disait la même chose que ce que Gribouille pensait. Cette voix était noire, sombre et mielleuse […] ».
[7] In Œuvre, tome I, op. cit., p.1323. Noté ART suivi du numéro de la page.
[8] Voir Daniel Leuwers, op. cit., 1984, p.41 sq.
[9] ART, 1328 : « Ô, ton âme…/ ton âme à jamais seule en ce Jardin mouillé,/ et le jet d’eau fiévreux sous la pluie ! – ton âme/ abandonnée… ».
[10] D. Leuwers signale (op. cit., p.40 sq.) le premier titre de cet ensemble paru d’abord en revue a été « Regards sous la glace ».
[11] Pour le rapport à « Langue de Mallarmé », voir Béatrice Bonhomme, op. cit., p. 372 sq.
[12] « L’ère d’autorité se trouble/ Lorsque, sans nul motif, on dit/ De ce midi que notre double/ Inconscience approfondit// Que, sol des cent iris, son site/ Ils savent s’il a bien été,/ Ne porte pas de nom que cite/ L’or de la trompette d’été. »
[13] ART, 1326 : « Elle danse quelque part/ ce soir…// Il fait blanc et l’heure est/ seule…// la lampe chaude crayonne/ une lumière grasse – dehors c’est/ la glauque et toute nue nuit plaquée d’eaux stellaires. »
[14] Ibid., 1328 : « J’entends la nuit par le gravier des avenues,. Et les feuilles sanglantes en reposoir de mort,/ toutes frêles mains fanées chargées de caresses, / se dandinent dans l’eau poisseuse qui dort. »
[15] La deuxième strophe du poème évoque une robe mais le vers ne permet pas de l’attribuer clairement : « Des nuages je respire ce que j’aime,/ à l’azur gonflant la robe de ses gemmes. »
[16] « Le poète n’est pas un métaphysicien, ni un théologien ; et à la pensée du poète, l’évolution du travail commande une libre modestie. », En miroir, in Œuvre, tome II, op. cit.,, p.1142.
[17] Dans les années profondes, in Œuvre, tome II, op. cit., p.963. Noté DLAP suivi du numéro de la page
[18] Voir le poème de Noces (in Œuvre, tome I, op. cit., p.107. Noté NO suivi du numéro de la page.) qui commence par : « La terre avec son œil gris regarde passer le ciel ».
[19] ART, p.1329 : « Vois le jardin carré ».
[20] In Œuvre, tome I, op. cit.. Voir par exemple p.213, « L’œil et la chevelure ».
[21] Ce motif jouera un rôle
déterminant dans l’histoire entre Hélène (dont le nom consonne avec haleine) et
Léonide (DLAP, 1013).
[22] L’on pourrait songer à ce moment crucial dans Dans les années profondes (DLAP, 1026) qui indique à Léonide, après la mort de Pauliet, qu’il a franchi une étape sur le chemin qui le conduit vers Hélène et où l’on retrouve le jardin et le parfum : « C’étaient encore des communications qui s’étaient faites dans la nuit entre les êtres qui dorment, un arrêt de la destinée qui avait été rendu, si bien qu’un parfum de vie presque étouffant de saveur et de couleur entrait par la fenêtre, venait d’un magnifique pauvre jardin, et que toutes les choses que je voyais en marchant égaré de salle en salle dans le château, en dehors de leur beauté propre, étaient occupées à la même révélation. »
[23] ART, 1339 : « Litanie tiède des sofas/ enflant la lèvre ardant de peau/ l’étoffe intime au vieil ors las/ les sueurs à des yeux d’oiseaux.// Les cuisses, cuivres lourds des soies,/ fumant l’encens de seuil, qu’endore/ le fard entier et que flamboie/ la vigne vierge au sperme odore. »
[24] Une essence qui sera bientôt déterminée comme fautive. On pourrait songer à ce poème de l’ensemble intitulé « Des Déserts » (NO, 114) qui évoque « Ces femmes soyeuses des théâtres d’argent/ Non, spirales de péché », femmes images, reposant totalement en leur être et l’offrant totalement au regard.
[25] In Œuvre, tome I, op. cit., p. 7 sq. Noté PP suivi du numéro de la page.
[26] Le [vèr] de vert/vers/ ovaire/ ouvert se retrouve dans une image étrange de la dernière strophe d’un poème de « Variations » (ART, 1336) : « Il monte en nos étoffes nubiles/ un verre terreux de son désir/ pâle d’ogive translucide. » Dans la même perspective de dissémination sonore d’un mot et de l’obsession qu’il recouvre, l’on peut citer une strophe dans « Vers pour une décoration » (ART, 1342) où le [o] qui ouvre ovaire et qui était présent dans ogive revient avec insistance et cela dans un contexte qui insiste également sur la clôture : « À l’angle reclus sous les cadres,/ d’un froid guéridon olivaire/ l’ovale fontaine s’encadre. » Bien sûr, comme nous le verrons, l’on retrouve cette chaîne dans « Traditions intimes » et au cœur du lien entre le je et sa dédicataire (ibid., 1346) : « Et te dédie ce vers tremblant ».
[27] Cf. Daniel Leuwers qui relève le lien entre cet ensemble et Le Paradis perdu (op. cit., p.43).
[28] Cette ombre ou cette obscurité, dans son contraste avec la lumière, marque également le personnage de Paulina et son parcours. Cf. Béatrice Bonhomme, op. cit., p.177 ainsi que Lauriane Sable qui dans son ouvrage sur Paulina 1880 (Pierre Jean Jouve, une poétique du secret : étude de Paulina 1880, 2008, L’Harmattan, p.45 évoque le « physique ténébreux » de l’héroïne du premier roman (reconnu) de Jouve.
[29] La Faute, in Œuvre, op. cit., tome I, p.1212.
[30] Il serait intéressant de rapprocher ce passage (PP, 51) : « Elle est jetée, le dos sur une mousse inexplicable […] Elle s’apprête à recevoir la blessure inavouable », blessure qui l’introduira dans la temporalité et la rendra mortelle, des derniers vers de « L’Avril » : « Car il faudra qu’elle me meure à l’été/ sur la mousse douce d’un autre jour » (ART, 1332).
[31] Un poème de Noces, « L’arbre mortel », en fera le lieu d’une agonie et d’un combat. « Les racines se convulsaient dans le Désir/ L’arbre tuait le voyageur ! Le voyageur mit alors ses deux mains sur sa poitrine/ Et la lutte recommença et l’Ange revint […] » (NO, 99).
[32] Cf. l’ultime poème et le sens du verbe polluer (ART, 1349) : « Vous, c’était tout un printemps blanc/ du souple éclat que vous meniez/ entre vos doigts adolescents/ mignarde de vous polluer. »
[33] Cf. la citation de Mirbeau que donne le TLF informatisé pour ce sens de « intimité » (http://atilf.atilf.fr/dendien/scripts/tlfiv5/advanced.exe?8;s=785495115;) : « Combien il y en a qui sont indécentes et loufoques dans l'intimité, même parmi celles qui, dans le monde, passent pour les plus retenues (...). Ah, dans les cabinets de toilette, comme les masques tombent! (MIRBEAU, Journal femme ch., 1900, p. 45).
[34] PP, 51 : « Mais assurée et nue/ Elle s’apprête à recevoir la blessure inavouable,/ Elle est terriblement osée couchée en arrière ».
[35] Ibid., 54 : « La face de l’homme n’est plus que sauvage/ Dure elle avance en dessous, remue et renifle:/ Il rêve de ses bouches […] Et elle/ Reprend la leçon du Serpent la trouvant plus belle. »
[36] Cf. (ART, 1347), « je suis à l’auge de mes nerfs,/ néant jusqu’à sa frénésie » ou plus loin (Ibid., 1348) : « Pour, maître d’un parfum moins las/ aux croisières renouvelées/ humer les obscures marées/ Aveuglément de n’être pas. »
[37] « L’homme sauvé du soleil/ Ecoutait murmurer les immenses familles de choses vertes/ Et noires tellement serrées, qui répandaient de vastes odeurs de mémoire ; / Mais comme il s’appuyait au tronc l’arbre se referma. »
[38] ART, 1348 : « Sphynge dénudant de l’énigme/ la lascive mobilité,/ je complais à tes dieux intimes,/ androgyne de leur été. »
[39] Cf. pour le lexique religieux de cette première strophe et la tension entre la clôture, le secret et la transgression qui leur correspond, Lauriane Sable, op. cit., p.69.
[40] In Œuvre, tome
I, op. cit., p.1422.
[41] Cf. Enfance, in Œuvre, tome I, op. cit., p.1628 sq. qui évoque les pratiques onanistes de l’adolescent, ses remords – et significativement l‘on retrouve l’idée de clôture sur une mémoire qu’une intrusion avive : « La blette parole du prêtre/ Me fouaillait la mémoire,/ Elle traçait au fer rouge/ Toute la zone du remord. » - et bien sûr l’espoir qu’apporte l’été, saison de mort et de résurrection dans la possession : « Pourtant par les soirées chaudes,/ Quand plongeait l’hirondelle,/ Je croyais que du néant/ Sortirait enfin une femme ». L’on pourrait d’ailleurs poursuivre ce jeu d’écho et mettre ces deux passages en regard du poème qui dans Le Paradis perdu évoque la naissance d’Eve, « Le double Adam » (PP, 32) : « Quand elle court/ doublant l’homme, elle se souvient/ Des portes du réveil : / Elle avait les yeux ouverts seulement pour lui/ Lui endormi brûlait/ Et son flanc rouge où l’Esprit s’est produit. »
[42] Cf. Béatrice Bonhomme, op. cit., p.221 : « Sans enfermer la musique dans « la cave des instincts », Jouve enracine pourtant la musique dans un rapport primordial avec l’inconscient. ». Cf. également, Michèle Finck, « Jouve et la musique », in Nu(e), relecture de Pierre Jean Jouve, n°28, mars 2003, p.65.
[43] Op. cit., p.19 sq.
[44] Cf. Lauriane Sable, op. cit., p.56 et 105.
[45] En miroir, in Œuvre, tome II, op. cit., p.1066 : « L’influence fut néfaste. Elle me détourna de ma recherche, à la fois de mon réel et de mon possible, et plaqua sur mes grandes incertitudes un métier d’apparence autoritaire qui n’était pas le mien, en m’éloignant de mes premières amours, sans me guérir. »
[46] « Avenir », Pendant ce temps, in Œuvre, tome I, op. cit., p.1523 : « Notre amour à l’avenir/ (Ici et là nous serons toi et moi de brèves lueurs d’amour)/ Sera semblable aux maladies qu’il ne faut jamais avouer,/ Sera la tare solitaire dont on pleure et le motif d’isolement,/ La proscription – l’infirmité – le patient martyre. / Nous, clairs et bienfaisants,/ (Entre nos pareils doués d’amour mais non moins de haine,/ Doué de la force infiniment belle et mélangée),/ - Nous passerons la vie sans pouvoir notre vérité. »


Retour à la Page d'Accueil du Site
Site Pierre Jean Jouve
Sous la Responsabilité de Béatrice Bonhomme et Jean-Paul Louis-Lambert
Ce texte © Éric Dazzan
Dernière mise à jour : 20 Juillet 2009