
| Lectures de Pierre Jean Jouve |
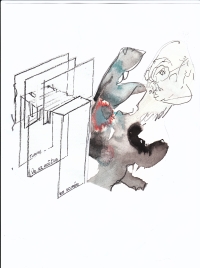
Retour à la page d'Accueil de la rubrique Lectures de Pierre Jean Jouve
par Laurence Llorca
Introduction
1ère Partie : La Discontinuité onirique au service d'une poésie intime
2ème Partie : Le Rêve comme une mise en scène de la culpabilité
Bibliographie
Vagadu est sans doute le roman de Pierre Jean Jouve qui ouvre le plus sûrement une voie vers les mondes souterrains de la conscience. L’exploration des profondes fondations de l’âme devient alors l’enjeu vital de son héroïne, Catherine Crachat. Cette dernière devient le sujet d’une expérience inédite qui espère résoudre cette douloureuse énigme au cours d’une initiation que rythment une multitude d’images oniriques. L’apparente discontinuité du récit tisse en profondeur le canevas de cette personnalité morcelée. Etrangère à elle-même, elle doit réconcilier cette constellation d’être pour enfin pouvoir se contempler Une.
Alors, nous pénétrons avec Catherine l’univers clos de son subconscient dont chaque manifestation nous renvoie comme en écho un fragment de son mystère, cette quête égotiste traduit cette même tentation d’absolu qui sous-tend la totalité de l’œuvre de Jouve car comme le dit Noémi dans le roman :
Ainsi la Petite X et Leuven sont les figures principales par lesquelles la vérité éclate au grand jour. Catherine, éveillée à la conscience de sa faute, voue une haine terrible aux deux démons qui lui font subir cette épreuve. Elle l’admet ouvertement lors d’un violent emportement contre son thérapeute :
Le
bloc de douleur que vous avez fait, on ne peut pas le porter. Mes larmes n’y
changent rien ; le bloc est trop lourd pour moi. C’est vous le
responsable, on devrait vous traîner devant les tribunaux. Vous m’avez
amoindrie ; vous m’avez plongée dans mon propre malheur. [V. 680]
Mais c’est encore Leuven qui lui révèle la véritable nature de sa haine.
« Quel
grief aurais-je contre vous au point de vouloir vous tuer ? »
« Je représente toute votre haine ; votre misère, votre déception. Je
représente ce barbouillage de vie et de mort dont vous ne voulez pas vous
détacher et qui cependant ne peut pas durer davantage. » [V. 775]
La même rancune s’installe contre la Petite X. Grâce à elle, une lumière crue est faite sur le mystère, le symbole une fois de plus chute dans la matière, le corps du Christ redevient charnel, il n’est que le père. C’est la Petite X qui soulève le suaire qui dissimulait le visage du Christ pour en révéler l’ordinaire réalité.
Ah, tu comprends aujourd’hui. Tu ouvrais le corps de qui ? du Christ, parce que tu dois aller voir ce qui s’est passé dans le mystère de ton cœur de cinq ans. Et qu’est ce qu’il devenait le Christ, quand le linge sur la figure avait glissé ? Un homme mort plutôt bête : le père. » [V. 734]
Elle se présente alors presque comme son ennemie, elle est ce traumatisme occulté par la conscience de Catherine qui revendique son droit à l’existence. Elle est la culpabilité qui la hante, avec et contre laquelle elle doit travailler.
C’est
bien toi, noiraude, enfouie prématurément parce que tu avais des sentiments
coupables, et qui longtemps as cherché
à te venger. C’est bien toi, c’est bien moi ; [V. 812]
Leuven et l’enfant sont le même ennemi, celui du miroir, celui qui renvoie à Catherine ce reflet avilissant, et pourtant comme le dira Noémi :
L’autre est finalement cette
présence hostile mais nécessaire à l’accomplissement de l’être. Dans Vagadu,
l’inconscient joue le rôle de
cet autre, du frère indomptable, il contient la menaçante
vérité, il est celui
vers lequel l’on se laisse glisser mais que l’on hait pour
l’image qu’il nous
renvoie de notre péché. Le personnage du Mongol symbolise
l’acceptation de cette culpabilité, il est l’homme
puissant pour
cette raison. Lui, sait que ce qu’il y a de plus
profondément humain réside au
cœur de la faute.
On sentait en lui une culpabilité dont il faisait usage, car il prétendait que l’homme doit à la Faute. Et ainsi Catherine tâtonnait pour connaître le Mongol ; [V. 701]
L'importance de la présence du regard d’autrui est une composante importante dans la mise en scène de la faute. Le rêve est le lieu où la chose sacrée est bafouée, le mythe chute dans le corps du rêveur et s’alourdit d’un intime secret, mais de même qu’elle a découvert sous le suaire le visage du père, Catherine soulève le rideau et pénètre au cœur de la représentation. Elle a regardé sa faute en face, elle a accepté cette autre facette d’elle-même, ce désir coupable. La pièce à laquelle Catherine assiste représente son propre drame, la théâtralité joue sur la dialectique du spectateur lui-même objet du spectacle.
Une des premières séquences de Vagadu présente les premiers symptômes du rêve et se situe dans une loge de théâtre, juste avant le spectacle. Théâtre surfait, lourdement ornementé, rideau en trompe l’œil et public vulgaire, c’est dans cette ambiance que Catherine sera propulsée malgré elle au-devant de la scène.
Les
corniches soutenues par des cariatides aux seins ballonnés, les piliers décorés
d’anges à trompettes, les velours débordants, le rideau portant un deuxième, un
troisième et un quatrième rideau en trompe-l’œil et une multitude d’ornements
sculptés à tous les étages, comme : flûtes de Pan, bouquets de violettes,
Reines de jeu de cartes, cornemuses et petites palissades ; cela semblait
vraiment inadmissible à notre époque. [V. 628]
Le décor est de mauvais goût, toutes les manifestations de sensualité s’empêtrent dans les formes absurdes des cariatides et dans les symboles dérisoires de stéréotypes amoureux. Catherine rapprochera elle-même ce lieu de celui d’un opéra Bouffe. Notre attention se porte également sur ce lourd rideau qui encadre la scène et dont l’importance théâtrale est récurrente dans l’œuvre de Jouve, ainsi dans Paulina :
Le
plâtre est également orné. On y a
représenté un énorme rideau jaune d’or.
D’un
coté ce rideau fictif retombe, par une habile illusion
d’optique, plongeant on
dirait dans la chambre même. [P. 5]
Nous nous trouvons de même au seuil du rêve, plus explicitement, au seuil de la révélation, pourtant l’espace ainsi organisé, voué à être la chambre de l’héroïne, présage d’un drame imminent.
La
chambre bleue a sept mètres de long, six mètres de large et prés de cinq mètres
de haut. Elle prend jour au moyen d’une fenêtre étroite emprisonnée par un
grillage. [P. 5]
L’espace du rêve semble déjà habité par les objets, vies inertes attendant patiemment l’héroïne qui ne manquera pas de faire son entrée. L’ambiance de la chambre est lourde de cette fatalité.
Dans Les Années profondes,
lors de la première union de Léonide et d’Hélène, le décor prend un ton
tragique. Le théâtre est la chambre de la femme désirée, et les rideaux
dissimulent l’alcôve au cœur de laquelle s’uniront les amants.
La
chambre était bleu sombre. La noblesse indicible de la chambre lui venait de
ses larges proportions autour d’une masse de velours bleu sombre, et cette
masse était le lit. Éloignés du lit, fort peu de meubles, de beaux meubles,
rangés contre les murs. Le lit était vaste et bas, mais non énorme ; une
seule personne devait y dormir ; aux quatre angles l’étoffe du baldaquin
tombait droite, formant une colonne de velours, et ces quatre colonnes à plis,
et la couverture, étaient du même bleu sombre. Cependant le lit était assez
éclairé ; car deux fenêtres distribuaient le jour dans la pièce tapissée
d’une espèce de soie ou de velours à fond blanc portant des rideaux bleu
sombre. En bleu sombre encore, trois chaises dont le haut dossier verni
s’appuyait contre le pied du lit. Trois chaises semblables à des personnes
muettes ; elles paraissaient les servantes du lit. Ce bleu sombre
demeurera dans toute ma mémoire d’homme. [An. Pr. 76]
La mise en scène est solennelle, prête à accueillir le drame, elle va nous plonger au cœur de l’aventure du couple. L'épreuve onirique va révéler le héros à son existence véritable. Les premiers pas qui conduisent l’amant au cœur inconscient du désir ont lieu lors des baisers dans la chevelure. Nous noterons que la chute alors pressentie présente des ressemblances avec celle de Catherine.
Comme
nuitamment — comme dans un rêve — je m’approchai de la bergère, je m’efforçais
d’arriver jusqu’à son corps qui me terrifiait, devant quoi j’avais le vertige.
[…] Mais j’allai, la femme du rêve approchait, puis devenait très proche, très
proche, ne faisant pas un mouvement. Et d’abord plus près que tout le reste
était la Chevelure magnétique et sexuelle. Je me conduisais encore assez bien
dans le tourbillon de mes sens, dans le vertige et la fatigue, pour faire ce
que j’avais résolu de faire : et lentement, profondément, je posai mon
baiser dans les cheveux.
Il
me sembla que je tombais si loin que je ne sortais plus mes lèvres des cheveux.
[An. Pr. 91]
Cette sensation de chute et la perte des repères qui l’accompagnent, sont les signes de l’émergence du rêve. La chambre, scène de l’acte amoureux appartient déjà à cet univers. Lorsque Hélène introduit Léonide dans son intimité la toute première fois, elle lui dit :
« Ici,
je dors, Léonide. » Et elle ouvrit la porte et mes yeux tombèrent dans la
chambre. C’est elle surtout que je vis dans la chambre. Ses attitudes étaient
différentes et superposées. [An. Pr. 76]
Autre espace du rêve, « Le Château » dans une courte histoire sanglante, présente lui aussi des caractéristiques de cet ordre. Le lieu déconcerte par son architecture menaçante d’un autre âge, avec sa façade empesée :
[…]
où les fautes de goût de manquaient pas — comme certaines tourelles accrochées,
certaines vérandas proéminentes le montraient assez, qui avaient été ajoutées
dans une époque bien vivante au bâtiment de style auguste — […] [H. S. 1292]
Il tombe même dans un rococo
quelque peu ridicule :
Mais
du côté du levant, ce n’étaient que tours, clochetons pointus et terrasses, une
fausse gaieté, un étrange assemblage de formes et de couleurs et deux larges
escaliers menaient aux flots où jadis s’étaient balancés les navires du
plaisir. Une jetée bizarre avançait encore un peu dans la mer, et enfin le
château devait s’avouer vaincu et se replier sur ses exubérances. [H. S. 1293]
Il est intéressant de noter que le rideau devient un motif récurrent du passage dans le rêve. Jouant sur l’échange, l’œil est placé au premier rang et contemple cette scène mystérieuse. Quelques minutes avant l’exposition, l’espace encore vide n’est que la promesse du désir sur le point de s’accomplir. Ces lourds rideaux dissimulent l’alcôve du plaisir. Ils constituent une présence fortement symbolique dans « Le Château ». Frappants par leur poids, ils imposent leur mystère.
Or
sur la fenêtre très haute dormait un rideau, un voile de fer. L’importance du
rideau ne m’échappait pas : mystérieux rideaux, difficiles à comprendre.
Tout à coup la vérité, ou une partie de la vérité, éclata dans mon esprit. A
travers le rideau, limite du château hanté, pouvait-on me voir encore ? Et
moi pouvais-je voir quelque chose qui eût pu se trouver derrière le
rideau ?—Suis-je vu ? y a-t-il un regard qui puisse percer le
rideau ? » et ensuite : « Puis-je voir au
dehors ? »-- Voir, être vu, telle était la question de cette heure
pathétique. [H. S. 1295]
Si le visiteur du Château redoute d’être aperçu dans cette chambre fatale « où ils étaient tous venus mourir », c’est qu’il se devine sur le point d’accomplir l’acte irréparable. De ces rideaux va naître la forme féminine tant désirée et pourtant si intimement liée à ce lieu de honte et de culpabilité.
Pouvais-je pressentir qu’il y aurait tant de sang sur les murs, sang de meurtre, sang d’époques de femmes ? Que j’entendrais tant de gémissements entrecoupés de rires ? Que tant d’ordures s’étaleraient partout, celles cachées dans les coins plus dégoûtants, celles étalées au milieu des pièces ? Que cent mille trucs d’avarice et de vol s’ensuivraient dont je verrais les restes accusateurs ? Que traîneraient ici ou la des outils bizarres de féroces peuplades, outils à éventrer, à châtrer, à scalper ? Que tout, enfin, serait fienteux ou sanglant ? [ibid.]
De même, Léonide craint plus que tout que son péché soit découvert. Au-delà de la mort d’Hélène, l’horreur réside dans la faute qu’il a commise. La liaison qu’il entretient avec Hélène s’obscurcit du sentiment de l’adultère et de l’inceste, jusqu'à devenir un écho du complexe d’Œdipe. Aussi craint-il d’être puni pour son acte par une figure paternelle et d’être jeté au-devant de la scène, mis à l’index par la bonne conscience morale. Le soin qu’il prend à agencer les objets auprès d’Hélène, avant que son entourage découvre son corps, est entièrement motivé par le désir de maquiller la faute, d’effacer sa présence.
Je
la recouvris pieusement de sa robe de soie, et la pensée du scandale ne me
quittant plus, je préparai la mise en scène nécessaire. [An. Pr. 88]
Tel un metteur en scène Léonide fait lui-même le choix de ce qui doit paraître aux spectateurs qui viendront. L’idée d’une représentation théâtrale persiste dans cet exemple encore, comme si la honte liée à la faute commise naissait du regard de l’autre, spectateur bien pensant, confortablement installé et juge implacable, l’autre, qui est aussi ce gendarme dans Vagadu, forme rigide et accusatrice. Or il n’y a pire bourreau que soi même, et sans doute la peur du scandale et la honte naissent-elles du regard que l’on porte sur soi. Le spectateur inflexible n’est-il pas l’être conscient dressé devant la psyché, contemplant et accusant le frère mauvais issu du miroir ?
Catherine n’est-elle pas la spectatrice de son propre malheur ?
Prête à assister au spectacle, c’est finalement vers elle que se tourneront tous les regards, la honte qu’elle éprouve est honte d’elle-même, de ce nom outrageant « Crachat » qui porte en lui l’essence du personnage. Avec le crime naît la culpabilité qui nous fait haïr l’autre tapi au creux de l’inconscient, celui qui par moments et trompant toute vigilance, émerge à la surface du moi et rappelle sa sombre histoire, bouleversant ainsi l’ordre que la conscience tente de conserver en temps normal.
Dans Le Château empli de crimes et d’opprobres, le jeune homme désire se garantir des regards extérieurs, garder sa faute enserrée entre ces murs dégoulinants de honte. Il sera l’autre, observant de l’extérieur les fenêtres closes, contemplant cette bâtisse impénétrable aux ornements dissuasifs puis il sera le jeune homme condamné, sur le point de commettre la faute irréparable, la même qui perdit ses prédécesseurs. Désormais pénétré par l’horreur des lieux, il est paralysé par l’angoisse d’être aperçu de l’extérieur. Catherine, elle, ne pourra se protéger de la rumeur accusatrice qui s’élèvera jusqu’à sa loge lorsque le régisseur proclamera son entrée en scène.
Le
régisseur daignait parler. Le régisseur disait un mot ; ce mot était un
nom ; le nom… […]
Cependant
le nom, qui roulait ainsi dans la salle, ne représentait encore que la moitié
de ce que le régisseur avait à dire, puisqu’il n’avait dit que :
CATHERINE ! Mais le régisseur ouvrait la bouche pour la seconde fois,
s’adressant toujours à la partie la plus intellectuelle et la meilleure du
public.
Et
quand il prononça alors :
…CRACHAT !
Une
tempête horrible s’éleva de tous les gradins et Catherine fut debout dans sa
loge. Certes elle savait bien que son nom n’était pas un beau nom. Mais jamais
elle n’eut pensé qu’on lui ferait honte… « La voilà prise devant tout le
monde. » « Oui, répondit-elle en titubant, il faut bien que je passe
par là. Mais c’était trop, trop, trop d’humiliation ! » [V. 630]
Si l’espace du rêve libère l’être de ses tabous, il place le héros face au crime accompli et au désespoir que provoque une telle révélation. Nous découvrons dans l’œuvre jouvienne l’importance du rêve comme vecteur de connaissance, certains textes d’Histoires Sanglantes sont construits selon les mouvements du subconscient. Le récit se nourrit des images déclinées dans l’inconscient, tout se fond en une même symbolique et l’histoire d’Ernest comme celle du jeune homme Dans une Maison devient l’expression d’un même traumatisme qui est celui de la naissance, de l’existence entachée de culpabilité.
Kurt Schärer écrit à cet effet [Schärer, 89]:
L’inceste
et l’adultère, l’homosexualité, l’auto-érotisme, le narcissisme et le sodomisme
se combinant avec les tendances sadiques et masochistes du cannibalisme ou de
la violence : toute la multiplicité des perversions patiemment énumérées
par Freud formant ensemble « cette tendance obscène et cette magie,
prodigieuse accumulation » dans laquelle peu à peu l’adolescent se perd.
Car en s’abandonnant à la rêverie, il cherche en premier lieu à s’abîmer dans
l’anonymat du ça (« Es ») ou du « non-moi », qui, selon le
tempérament du rêveur, est capable d’adopter mille formes diverses.
Dans les Histoires Sanglantes, le rêve demeure l’espace où les instincts s’épanouissent et où la faute est accomplie, le terrain de jeu du ça. L’espace est lourd d’un drame menaçant et semble même en porter les stigmates.
Cependant au cours de ce roman de Jouve, l’univers inconscient de son héroïne s’allège et gagne ainsi en sérénité. Au terme de Vagadu, Catherine Crachat semble finalement soulagée d’un passé qui ne lui appartenait pas et qui hantait son existence. La cure psychanalytique qui la porte vers la connaissance de soi la réconcilie avec toutes ces présences hostiles qui lui renvoyaient jadis son énigme menaçante. Dans les dernières pages du roman, elle est claire et apaisée sans aspérités apparentes, sans doute offerte au bonheur, et pourtant considérablement moins belle. Luc Pascal déplorera sa transformation lors de leur dernière rencontre, conscient que le plus précieux des trésors réside dans les tortueux replis de l’âme.
[P.] Paulina 1880, (1925), Folio, 1974.
[V.] Vagadu, (1931), Œuvre II, Texte établi et présenté par Jean Starobinski, Mercure de France, 1987.
[H. S.] Histoires Sanglantes, (1932), Œuvre II, Texte établi et présenté par Jean Starobinski, Mercure de France, 1987.
[C.] Commentaires, (1950), Les éditions de la Baconnière, Neuchâtel, 1950.
[An. Pr.] Dans les Années profondes - Matière céleste - Proses, Présentation de Jérôme Thélot, Poésie/Gallimard, 1995.
[Shärer] Shärer Kurt, Jouve, Thématique du Mal, Lettres Modernes, Minard, 1984.
[E. M.] En Miroir, (1954),
Œuvre II, Texte établi et présenté par Jean Starobinski, Mercure de
France, 1987.


Retour à la Page d'Accueil du Site
Site « Pierre Jean Jouve »
Sous la responsabilité de Béatrice Bonhomme et Jean-Paul Louis-Lambert
Ce texte © Laurence Llorca, 2008
Texte reçu le 14 février 2008
Première mise en ligne : mars 2008
Dernière mise à jour informatique : 23 février 2010