
|
Lectures
de
Pierre
Jean Jouve
|
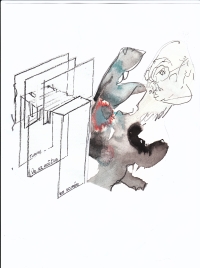
Retour à la page d'Accueil de la rubrique Lectures de Pierre Jean Jouve
Le Chant raisonnable des Anges
par Jean-Yves Masson
Quelques réflexions sur la place de la musique dans la poésie de Pierre Jean Jouve
1. Jouve, poète musicien
De tous les arts, c’est la musique qui a le plus constamment requis, en Pierre Jean Jouve, le poète. Sans doute rencontre-t-on aussi dans sa poésie des références plastiques, des transpositions de tableaux, mais c’est bien l’art musical avec lequel il a entretenu le dialogue le plus fondamental pour l’élaboration de sa poétique. Jouve offre même un exemple à peu près unique en son temps de culture musicale complète chez un écrivain français. André Gide et Romain Rolland, en ce siècle, ont certes témoigné eux aussi d’une compréhension très profonde de la musique, mais les curiosités musicales de Jouve vont de Monteverdi à Berg ou à Bartók sans solution de continuité, ce qui n’est pas le cas de Rolland et de Gide, plus limités dans leurs choix, du moins ceux qu’ils rendent publics (Rolland, historien de la musique, auteur en 1895 d’une thèse marquante sur l’histoire de l’opéra en Europe, auteur de grands livres sur Beethoven, ne semble pas avoir défendu ni particulièrement aimé la musique de son temps, à l’exception de celle de Richard Strauss). Jouve a eu lui aussi, naturellement, ses préférences, ses musiciens d’élection, mais l’éventail de sa culture musicale est très large et, surtout, il se distingue par son attention à la musique de son temps ; il est notamment l’un des premiers intellectuels français à comprendre l’importance de l’École de Vienne.
Au siècle précédent, l’intérêt de Mallarmé ou de Baudelaire pour Wagner, celui de Victor Hugo pour Palestrina ou Beethoven, ou encore l’amour de l’opéra italien chez Stendhal, ont certes pu offrir des exemples d’un discernement remarquable dans la reconnaissance du génie de certains compositeurs privilégiés, mais à chaque fois la rencontre avec un musicien semblait correspondre pour eux à une nécessité presque didactique, au besoin de se servir de l’exemple musical pour accentuer tel ou tel aspect d’un art poétique déjà constitué. Jouve, au contraire, est peut-être le premier chez qui la rencontre de la musique semble une donnée première, un fait biographique brut, un élan d’amour et d’admiration spontané que l’écriture devra par la suite interroger.
Cette interrogation, dans la mesure où elle est suscitée par la musique elle-même et non dictée par une curiosité d’esthète, pourra devenir une épreuve, une mise à l’épreuve des possibilités du poème. C’est au point que la musique, au lieu d’offrir seulement un exemple stimulant de création artistique, sera aussi bien une occasion de doute et de découragement qu’une source de réconfort : les pouvoirs de l’écriture, par elle, pourront être cruellement remis en question, au point que les limites de la poésie sembleront parfois presque atteintes. C’est ce passage à la limite, cette menace même que la musique fait peser sur la poésie, que nous voudrions interroger ici.
2. Poésie et musique : une passion inquiète
De son amour, de sa passion pour la musique — qui lui vient, comme il l’a raconté, d’une pratique assidue de l’improvisation au piano dès son adolescence — Jouve, dans En Miroir aussi bien que dans un certain nombre de poèmes, ne cache rien : chez les musiciens qui lui plaisent, dans l’émotion qui le bouleverse face à une œuvre musicale, il reconnaît d’emblée une énigme nécessaire à laquelle il vient se heurter, l’énigme d’un art doué d’une qualité présence, d’une densité ontologique supérieure à celle des autres arts. Sans doute faut-il attendre les poèmes tardifs pour que cette supériorité soit définitivement affirmée, ou du moins pour que la question de l’éventuelle suprématie de la musique soit ouvertement posée ; mais elle l’est en des termes qui ne laissent pas douter de l’acuité qu’a pu revêtir pour Jouve, bien plus tôt, cette question : que peut la poésie face (ou comparée) à la musique ? C’est dans le poème de Moires intitulé Chant de la terre que l’évocation de la musique de Mahler donne lieu au plus spectaculaire aveu :
Des douleurs isolées des exaltations
De la beauté commune et de l’ivresse mère,
J’aurais voulu l’avoir en ma création. (1062)
Aveu dont la
solennité est soulignée par le caractère quasi obligatoire de la
diérèse à la rime, que telle affirmation d’En
Miroir
confirme sans ambiguïté (« Le poète en moi a toujours envié les
musiciens »1),
et qui annonce le caractère presque didactique des poèmes de
Ténèbre
consacrés à la musique, dont l’un affirme avec non moins de
hauteur :
La plus grande vertu s’attache à la musique (1117).
La plus grande : ce n’est pas là simple formule, mais une affirmation de supériorité absolue, basée sur une expérience intime :
J’aurai vécu plus près de ce torrent sonore [...]
Que de n’importe quelle vérité de l’être
Plus près que de la femme et plus que de l’amour
Et plus que la Poésie et de la parole elle-même (1118).
2. Ibid., p. 1178.
3. Commentaires, p.122 (Béla Bartók).
4. Le poème d'Yves Bonnefoy À la voix de Kathleen Ferrier, digne tentative dans le même sens, étant finalement demeuré unique dans l'œuvre de Bonnefoy, davantage requis (statistiquement du moins, et dans l'état actuel de son œuvre) par les arts plastiques et par les problèmes de la représentation.
D’autres confidences de la première partie d’En miroir nous apprennent que Jouve reconnut très tôt (dès la crise de 1902 où il se laissa aller à ses tentations éthéromanes) le rôle de la musique dans la reconstruction et la structuration, de sa personnalité : « Tel Saül écoutant la harpe de David, je me secourais moi-même »1, dit-il en parlant des longues heures passées au piano.
De tout ce qu’a écrit Jouve sur la musique, et en particulier des comptes-rendus rassemblés dans le précieux volume intitulé Commentaires, il ressort que la musique, avant même d’être l’objet d’une interrogation conceptuelle, aide avant tout à vivre : « La Musique fut la passion de ma vie. L’Oiseau Magique a fidèlement retenti à l’oreille de mon cœur. J’ai trouvé, dans les œuvres du son, guérison et libération de façon continuelle. » 2 La guérison qu’apporte la musique consiste en ceci, qu’elle a le pouvoir de mettre à jour la personnalité profonde de celui qui écoute, de lui donner le courage et la force de se construire, de renaître, d’atteindre à sa propre vérité par le haut, en quelque sorte, en ce lieu que les mystiques français du XVIIème siècle, avec Pierre de Bérulle et Jeanne de Chantal, nomment « l’extrême pointe de l’âme ». Et cette opération, dans la pensée de Jouve, a lieu « au sein de la sensualité la plus forte » 3, elle n’a aucun caractère abstrait, aucune fausse pureté
On saisira mieux l’originalité de l’attitude de Jouve face à la musique si l’on compare ces aveux, par exemple, avec le silence d’un Paul Valéry, dont on sait qu’il fut lui aussi particulièrement sensible à l’émotion musicale, mais chez qui cette sensibilité excessive fait rapidement l’objet d’une autocritique, d’une mise à distance — comme chez Rilke, qui mit longtemps à surmonter sa défiance vis-à-vis de la musique — et pour finir d’un silence. Il faudrait s’attarder plus longuement qu’on ne peut le faire ici sur ce contraste entre Jouve et Valéry ; jamais Valéry n’aurait publiquement reconnu qu’il enviait les musiciens. Pourtant, on sait aujourd’hui que le premier abandon de la poésie, chez Valéry — le moment de la « crise de Gênes » — correspondit au sentiment de ne pas pouvoir rivaliser avec la puissance de la musique, notamment avec la force d’un Wagner ; mais on ne le sait que par des confidences indirectes et par la consultation des Cahiers : Valéry a fait silence, en public, sur ce désespoir du poète face à la puissance du chant comme sur bien d’autres mystères de la création poétique. Or c’est dans la musique, justement, que Valéry a trouvé la force de revenir vers la poésie, une fois achevée la phase la plus corrosive de son examen des pouvoirs du langage : La Jeune Parque a été conçue comme un récitatif d’opéra destiné à une voix de contralto, dont le modèle se trouve principalement chez Gluck, probablement dans Orphée et Eurydice. Et là encore, nous ne le savons qu’après-coup, par des lettres, des confidences rapportées, par les Cahiers — alors que le dialogue avec la musique est la matière même, la substance, de plusieurs textes de Jouve, y compris des poèmes.
Si Valéry a pu résumer le symbolisme dans lequel, héritier de Mallarmé, il acceptait pour finir d’inscrire son œuvre, par cette tentative de « reprendre à la musique son bien » (et il s’agit donc moins d’une rivalité que de la restitution à la poésie d’un pouvoir qui lui était naturel dans le monde antique et jusqu’au Moyen Age, celui d’occuper, grâce à la lyre, au luth, à la cithare qui accompagnaient les poèmes, une bonne part de l’espace aujourd’hui dévolu à la musique), le dialogue constant de Jouve avec la musique trace pour la poésie une voie différente, probablement plus riche d’enseignement pour l’avenir. Il s’agit moins de rivaliser avec les pouvoirs de la musique par les artifices du vers, le jeu des assonances et des allitérations (ce qui est bel et bien une part importante du travail du vers valéryen) que de trouver les moyens, pour le poème, d’avoir une densité ontologique suffisante, cette « puissance d’être » que nous citions plus haut, un pouvoir d’émotion et de présence assez fort pour tenir tête à l’œuvre musicale et non pas seulement la copier. Il s’agit de se placer à la même hauteur. Ainsi seulement peuvent s’expliquer des déclarations provocantes chez Jouve, comme celle que l’on trouve dans Apologie du poète : « Pour ma part, je n’ai aucun goût pour la beauté formelle ou d’harmonie ; j’aime la beauté de force, d’essence » (1185) — déclaration sur laquelle on se méprendrait si l’on croyait qu’elle signifie une indifférence de Jouve aux questions de forme. Une telle attitude n’a de sens que parce qu’elle entérine, dans le travail rythmique sur le langage, l’abandon du vers classique auquel se cramponnait encore, malgré tout, Valéry. Libéré de l’influence de Verhaeren ou de Jules Romain qui l’avaient incité à écrire trop de vers sans charpente, mais se souvenant d’Apollinaire, Jouve s’est consacré à l’élaboration du vers libre en le concevant non comme un reniement des mètres classiques, mais comme leur élargissement. Jouve est ainsi le grand inventeur de la forme dans laquelle, après lui, Pierre Emmanuel, Yves Bonnefoy, Philippe Jaccottet ont inscrit leur œuvre, forme qui a aussi ouvert de nouveaux horizons à la traduction de la poésie en mettant fin au règne des adaptations : rigueur du sens et rigueur rythmique devenaient par ce vers non seulement conciliables, mais complémentaires et conaturelles l’une à l’autre.
Mais si cet instrument s’est avéré fécond, Jouve nous paraît être plus profondément encore à l’origine d’une problématique qui n’a peut-être pas encore donné sa pleine mesure chez un autre que lui. 4. Son dialogue avec la musique, en effet, sera moins conçu comme tentative prométhéenne de conférer au poème le rang d’une musique des mots en se fiant au travail sur le matériau verbal, que comme exigence de faire face, et pour une part de résister à l’assaut de la musique par un travail qui ne peut porter que sur le mystère même d’un langage à plusieurs voix.
3. L’exigence de répondre
2. Commentaires, p. 120 (Béla Bartók).
La musique a joué un rôle capital dans le retournement, dans la conversion par laquelle Jouve s’est résigné à affronter la violence de ses propres pulsions pour en conquérir la maîtrise poétique, c’est-à-dire pour en être quasiment le recréateur. C’est pourquoi, de la musique, il peut dire dans Ténèbre qu’elle est « le conte de nous-mêmes » (1117). Dans l’acheminement de Jouve vers sa Vita Nova, dans cette seconde naissance qui marque le début de l’œuvre poétique véritable, le reniement des publications passées compte moins, on le sait, que la décision de bâtir une nouvelle œuvre pour se bâtir soi-même ; on ne saurait oublier que le séjour de Salzbourg, lieu emblématique de la musique occidentale évoqué dès le poème Mozart (95-96) au début des Noces, a joué un rôle fondamental dans cette « conversion » de Jouve à l’exigence poétique véritable1, c’est-à-dire à ce qu’exige l’art pour être révélation de l’inconnu et conquête sur les terres de l’indicible.
Toute sa démarche de créateur face à l’œuvre musicale sera donc moins pour le poète de se demander comment « reprendre à la musique son bien », selon le mot de Mallarmé, que de chercher les moyens pour la poésie de rivaliser avec cet art et de lui répondre, d’en constituer, serait-on tenté de dire, le contrepoint. Il y a pour Jouve, face à la musique, une obligation pour la poésie de répondre, d’affirmer sa « puissance » face au « torrent sonore ». Car dès que Jouve parle de musique, c’est bien le mot de « puissance » qui lui vient à l’esprit, d’une manière presque obsessionnelle. C’est ainsi qu’il parle d’une « puissance d’être / par le son absolue et sans objet » (1117), qu’il affirme que l’auditeur d’une œuvre musicale est « agrandi de puissance », ou qu’il emploie le mot vertu dans son sens latin de force ou puissance mâle lorsqu’il affirme que « la plus grande vertu s’attache à la musique » (11717). Cette puissance d’être est ainsi un mouvement qui balaye irrésistiblement le sentiment ou même la réalité de l’être individuel, comme cette « cavalière de la mort / sonnant l’orage pour le malheur de la terre » qu’évoque dans Mélodrame le poème Musique (997) sur lequel nous reviendrons plus loin.
La musique sera donc reconnue par Jouve pour l’art qui lui impose, en tant que poète, d’être « à la hauteur » d’une telle puissance, de lui faire réponse avec ses moyens propres ; et cela, sans doute, parce que la musique dans son incomparable puissance émotionnelle lance à la poésie un défi, mais aussi, et peut-être plus profondément, parce qu’elle est elle-même la réponse — le répons — à quelque chose qui la dépasse, qui transcende toute musique particulière, à quelque chose de proprement inouï, inentendu ; elle-même, la musique, donne donc à la poésie la mesure d’une rigueur, elle indique la direction d’une exigence et pose la question du statut du poème comme « chant ». Tout cela explique pourquoi la « transposition d’art », la description de l’impression musicale, si elle peut être une étape sur le chemin à explorer, ne saurait satisfaire Jouve et constituer en soi la réponse.
C’est, d’abord, que la musique défie la description : « La pauvreté des descriptions de la Musique provient de ceci : que l’on ne décrit pas un abîme mental et que l’on ne trouve même point de mot pour dire qu’il y a abîme »2. Mais c’est surtout — hypothèse que nous donnons ici pour telle, car Jouve ne l’a jamais, à notre connaissance, directement formulée ainsi — que le poème, comme chant, ne peut en fait rivaliser avec la musique par le seul jeu des sonorités. S’il y a chant dans la poésie, il ne peut advenir qu’autrement, selon d’autres critères, selon d’autres efforts que la simple production d’effets sonores qui ne valent, quand ils existent, que comme signes d’enjeux qui les dépassent. Quand on compare les sonorités du poème au déchaînement de l’orchestre ou même à la simple puissance d’émotion d’une mélodie, on comprend que le combat, s’il devait se situer sur ce terrain, serait perdu d’avance, et que comprendre la nature musicale de la poésie serait impossible si l’on ne posait pas en même temps la question du sens qui est celle de la substance du poème. Or, pour le Jouve de Mélodrame :
Tout chant est substance à
Dieu et même si Dieu absent. (973)
Mais si l’on regarde mieux les poèmes de Jouve, on s’aperçoit que la supériorité de la musique, aussitôt affirmée (le plus souvent dans les poèmes tardifs, quand vient le moment de tirer les leçons de l’œuvre), est toujours rétractée, retirée sur le mode du repentir, du surgissement d’une réserve, comme si à chaque fois que le poète est tenté de constater les limites de son pouvoir face à la puissance de la musique, il devait tout aussitôt constater que la musique elle-même se heurte à d’autres limites. C’est par exemple dans l’un des poèmes sans titre de Moires, composé d’une seule phrase qui s’étire sur dix vers et s’adresse à la musique (« Ô Musique, toi mère des voluptés vraies...»), une première séquence de huit vers où Jouve affirme qu’à l’approche de la vieillesse, sa poésie est comme absorbée par le souvenir des émotions musicales qui seules lui permettent de poursuivre sa route, et de « faire encore entre tes rayons et tes plaies / un dernier pas ! » (1098). Mais les deux derniers vers semblent, de façon presque imperceptible, laisser planer un doute sur le pouvoir réel de la musique, puisque qu’il s’agit pour le poète d’être, au terme de cette longue phrase, celui qui
Pense : et que moi encor que moi encor je dise
Le semblant d’un Pouvoir aussi divinement (1098).
Que faut-il comprendre ? Est-ce au poète que sera accordé un semblant de pouvoir semblable à celui de la musique ? Ou n’est-ce pas plutôt, si on lit attentivement, la musique elle-même qui, fût-ce « divinement », possède le « semblant d’un Pouvoir » mais non une puissance absolue ?
4. Les sons et les mots : éléments d’un conflit
La dernière partie du Tombeau d’Alban Berg (928-29) semble confirmer une telle réserve. On y lit une première affirmation selon laquelle « la musique est plus rare encore que l’amour » (qui ne porte pas cette fois-ci sur la puissance de la musique mais sur la difficulté d’atteindre à l’essence musicale pure, et par conséquent sur le caractère miraculeux de celle-ci). La musique y apparaît comme la reine des arts, dépassant en puissance et en vérité, non seulement la peinture, mais aussi le « soleil des mots » aux « rayons toujours noirs ». Pourtant, le poème débouche sur un tercet qui tempère l’affirmation première par un cependant qui, à le lire de près, rétracte ce qui a d’abord été posé, mais toujours avec une ambiguïté car on peut le comprendre aussi comme un indication de coïncidence temporelle et logique :
Cependant l’âme sert de cadre au seul amour
Et le son touche au mot par les arbres du soir
L’essence arrive à Dieu dans la langue des ondes.
Que « le son touche au mot » (même si c’est dans la demi-lumière de ce qui n’est plus clairement perceptible, dans un horizon où le langage ne parvient pas mais que la musique n’atteint pas non plus), cela signifie bien qu’une convergence est possible, mais aussi que le mot malgré tout, parce qu’il est porteur de sens, parce qu’il peut désigner l’essence, l’idée, recèle un mystère plus élevé qu’un art qui demeure toujours en deçà d’une signification clairement assignable. Le souvenir de Hugo, de celui pour qui le mot c’est le verbe et le verbe c’est Dieu, n’est pas loin.
Cette même convergence du son et du mot, un poème de La Vierge de Paris sur le chant grégorien l’évoque comme une sorte de miracle. Il commence par traduire une sensation sonore par une image visuelle, mais d’une telle abstraction que l’on songerait, si l’on oubliait le titre qui figure au-dessus du poème, à une description inspirée par L’oiseau dans l’espace de Brancusi :
Des vols fixes d’oiseaux parfaits qui sont sans air... (489)
On notera du reste au passage la polysémie du mot « air », puisque le grégorien, en effet, ne comporte rien qui ressemble à une aria : ses oiseaux « profondément nus » ne seront donc jamais les rossignols du bel canto. Mais le plus passionnant dans ce poème est, après le premier quatrain, la longue phrase que l’on croit plusieurs fois voir finir et qui se prolonge sur douze vers, comme la mélodie dans le chant grégorien, et qui s’ouvre par la prise de conscience d’une sorte de fait miraculeux : c’est que
ces oiseaux sont des mots et sur des lèvres nés...
2. Commentaires, p.119.
Et tout à coup c’est comme si le poète se rappelait ici l’existence de ces mots qui s’étaient fait oublier, métamorphosés en pure matière sonore, alors qu’ils sont pourtant toute la justification du grégorien, commandant par leur sens, leur syntaxe, la place des accents grammaticaux, l’agencement du souffle de la mélodie. Nous aurons à nous souvenir de ce mouvement par lequel le mot réinvestit une musique « sans air » et par lequel la syntaxe mime le mouvement profond de l’ondulation mélodique grégorienne.
L’essai sur Alban Berg écrit par Jouve juste après la création du Concerto à la mémoire d’un ange à Barcelone en 1936, lui aussi repris dans Commentaires, commence par une véritable théorie de la musique qui donne de celle-ci une définition abrupte : « la Musique, c’est le Chant, et le Chant, c’est “ quelque chose de sacré à dire ” ». L’emploi de ce verbe dire, si important pour Jouve, doit nous rendre attentifs à la question de la parole : que dit la Musique ? Elle ne « dit » pas peut-être « le sacré » au sens où elle serait douée de parole, encore que, dans la transposition poétique que fera Jouve de ce même Concerto de Berg,1 la citation du choral de Bach Es ist genug soit le témoignage de son attention particulière au rôle de la parole, au pouvoir des mots dans la musique — de même que Jean Starobinski a pu montrer que le poème Vrai corps était construit sur le souvenir précis des paroles de l’Ave verum de Mozart. Mais plus profondément, si la musique « dit » le sacré, c’est au sens étymologique du verbe dire, ce sens latin de dicere qui signifie d’abord montrer. La musique montre ce qu’aucun mot ne désigne, et si elle ne l’exprime pas, elle a l’immatérialité suffisante pour suggérer la direction d’une assomption du réel. Mais c'est là, justement, un geste qui porte en lui-même, de n’être qu’un élan, qu’un envol, son propre inaccomplissement, et si le mouvement de la musique épouse les moindres oscillations de l’âme humaine, c’est aussi parce qu’elle indique une direction dont elle ne connaît pas le terme.
Le début de
l’admirable essai sur Béla Bartók
repris dans Commentaires
apporte
une confirmation de cette réserve que nous avons cru percevoir dans
les deux poèmes analysés plus haut. Jouve y reprend sa définition
de la musique comme « absorption du temps en attente religieuse »,
manière pour l’homme d’obliger « l’éternel » à « venir se
placer sur chaque instant présent », en une suite de formules qui
mériteraient toutes la citation et l’analyse. Si belles et si
affirmatives qu’elles soient, ces formules convergent pourtant vers
une réserve explicite qui cerne de nouveau les limites de la musique
et laisse pressentir la nécessité pour la poésie de prendre, à
partir d’un certain point, la relève : « La Musique offrirait
donc un raccourci et une illustration de tout l’esprit, si elle
pouvait encore avoir l’expression des idées claires — nommer —
suprême lumière qu’elle ne peut jamais obtenir »2.
On voit que le mouvement de repentir constaté plus haut dans des
poèmes tardifs est déjà présent dans cet article de 1938.
5. Musique et Grâce
Mais Jouve va plus loin dans l’analyse de cette grâce refusée (car c’est bien à une problématique de la Grâce que renvoient les deux mots lumière et obtenir, qui appartiennent au vocabulaire de la conversion religieuse à l’âge classique). Parce que la musique a ce don de transfigurer tout ce qu’elle touche, sa « faute », son péché, est de rendre la mort admirable — ce que la mort, qui est l’un des noms de la catastrophe qui hante l’esprit de Jouve, ne saurait être, étant la conséquence directe du péché originel ; la musique réconcilie, elle exalte, mais elle ne peut élever l’esprit jusqu’à la notion de l’universel moral à travers la considération de la mort. La musique embellit la mort : il n’appartient qu’à la poésie de la saisir dans sa vérité, qui est horreur, néant, agonie, mais aussi révélation de la possibilité d’un salut. Nommer est le privilège d'Adam, même déchu ; les premiers musiciens ne sont pas les hommes, mais les anges, dont le Coran dit qu'ils apprennent de l'homme les noms des choses. Jouve a reconnu ce caractère angélique de la musique, et il a su que la poésie ne pouvait renoncer à cette « ambition d'ange » sous peine de céder à la mort et au chaos : alors, « le vers ne serait que le jeu des osselets de la mort » (973). Jouve accepte les fondements théologiques de son esthétique : Dieu est même peut-être avant tout, chez lui, un principe d'ordre, un « témoin » nécessaire du poème qui est lutte contre le chaos et conjuration de ténèbres.
Et cet « Adieu » qu'est la poésie1 impose un ordre à ce chaos qui n'est pas seulement rythmique, mais sémantique, tout en mimant le mouvement de la mort. On dirait volontiers que Jouve a d'autant plus subi la fascination de la musique qu'il en a craint le pouvoir, car la musique, on le sait depuis Schopenhauer, peut être aussi l'expression de la séduction d'une mort faite belle, rendue acceptable. Or pour Jouve, poète du Paradis perdu, l'idée rilkéenne que la mort n'est qu'une autre face de la vie est inacceptable. Jamais Jouve n'a abandonné, au contraire d'un Rilke qui s'est peu à peu détourné du christianisme, l'idée profondément chrétienne (si « difficile » que soit par ailleurs son christianisme) de la Mort comme Mal absolu, marque du péché sur la création dont Dieu ne saurait être tenu pour responsable. Et il craint donc dans la musique, en même temps qu'il accepte, ce geste de trop de beauté conférée à la catastrophe ontologique qui fonde notre condition. L’opéra seul, parce que dans son essence il est construit sur un poème dramatique, peut parfois permettre à la musique de se hausser à une vision de la mort comme catastrophe, ainsi dans la fin du Don Juan de Mozart, ou dans le meurtre de Lulu. Il est vrai que la musique « pure » elle aussi est capable de se transcender elle-même, de parvenir à cerner la catastrophe, à dire la mort en tant qu’elle est le sceau par lequel est scellée la destinée humaine, dans son irrémédiable nudité. Si le Concerto à la mémoire d’un ange, dans l’article de Commentaires, est dit « unique », c’est précisément parce qu’il n’embellit pas la mort de l’extérieur mais, en tant que Requiem, est une authentique « expression de la catastrophe par l’intérieur ». Mais c’est là une rareté, un miracle : en général, il manque à la musique le sens de cette catastrophe, c’est-à-dire qu’il lui manque le sens tout court, car — et c’est là encore un point que nous prenons sur nous d’expliciter, Jouve s’étant tenu à l’écart de toute formulation philosophique qui l’eût inévitablement appauvri — toutes les significations humaines et la faculté même du langage semblent pour lui liées à la mort ou marquées du sceau de la mort. C’est peut-être ainsi qu’il faut comprendre les deux derniers vers de Chant de la terre : comme un rappel de ce que la musique n’est pas suffisante en soi, si désirable que soit sa puissance.
Meurt dans l’opium divin de douleur elle-même. (1062)
Vers énigmatiques, mais qui, nous semble-t-il, laissent deviner comme un réveil de la conscience, comme un sursaut qui prolonge les réserves précédemment analysées sur le caractère absolu de la musique, qui peut n'être qu'une drogue apaisante, fût-elle « divine ». Le poète soudain se souvient ici que le sens profond de la douleur comme révélation de la condition mortelle de l’homme n’appartient qu’au langage, que seul le langage est porteur d’une authentique « leçon de ténèbre », car c’est bien vers cette leçon que converge toute son œuvre. Or Chant de la terre est aussi, nous l’avons vu, l’un des textes où nous avions d’abord cru pouvoir surprendre un aveu de la supériorité de la musique sur la poésie. La fascination exercée par la musique n’est donc pas simplement, au soir de la vie de Jouve, une remise en question des pouvoirs de la poésie, elle est aussi une incitation à envisager ce qui, dans la poésie, est irréductible à une rivalité avec la musique.
6. Vers une réconciliation de la poésie et de la musique
Aussi la prise de conscience du conflit entre musique et poésie va-t-elle déboucher pour Jouve sur une possible réconciliation : l’exemple du chant grégorien nous la laissait entrevoir. Avec lui, nous avons pressenti un point de convergence où il serait possible de parler de la poésie comme de la musique, ou mieux de parler musicalement de la poésie, en poésie, de la faire exister comme composition musicale, de faire appel aux mêmes processus d’Invention qu’en musique, à la notion de thème par exemple, à l’idée que le poème est phrase au double sens grammatical et musical du mot. Ceci ne saurait se faire qu’en pliant la poésie à la loi de la mort, en lui faisant exprimer la loi du temps qui est perte, dégradation, mais malgré tout rythmée et mesurée d'une mesure humaine : le privilège de la musique comme de la poésie est en effet de pouvoir s’analyser comme suite de phrases, et c’est la syntaxe qui va être le grand secret de l’élaboration poétique du chant humain. Invention, phrase : ces mots sot les termes-clés de Mélodrame et de Ténèbre.
Car si le point qui fascinait Jouve dans Grégorien était celui où le mot réapparaissait derrière le son, et si ce suspens est pour lui analogue, dans ce poème, à l’ambiguïté entre le corps et l’âme (car les oiseaux demandent « s’il sont toujours du corps ou peut-être de l’âme »), il en résulte que cette ambiguïté doit être maintenue dans le poème par un suspens, semblable à celui de la mélodie qui hésite sur la direction à prendre, et que ce suspens ne saurait être obtenu pleinement que par le recours aux artifices de syntaxe les plus subtils. La poésie, ce serait peut-être cela : un discours où la pure fonction utilitaire de nommer est suspendue, non par le recours systématique à l’irrationnel que Jouve a toujours trouvé puéril chez les surréalistes, mais par le travail perpétuel de l’ambiguïté du sens. Alors, appeler les choses, ce sera vraiment les appeler non pour en faire usage, mais pour poser la question de leur entrée dans notre conscience et de leur saisie même par le langage qui est notre limite et notre élément. Qui dit suspens dit déséquilibre, et l’on dirait volontiers que la musique a pour Jouve la même définition que celle que Valéry donne de la danse : une chute indéfiniment retardée.
Dans la perception que Jouve a de la musique, la dissonance est première parce que la tension est première, jusqu’à l’oxymore dont l’emploi est chez lui obsessionnel et dont il eût peut-être trouvé une justification dans la théorie de la coïncidence des opposés du Cusan. la consonance ne peut être qu’une résolution momentanée de la tension. Citons parmi bien d’autres exemples :
Tout chant est substance à Dieu même si Dieu absent
Harmonie avec le torrent de dissonance dans l’orchestre (973)
Seule la dissonance prend congé du monde hérité des conventions et mime le passage de la mort et la nécessaire épreuve du Mal — Jouve sait que certains accords fascinants étaient nommés par les théoriciens classiques diabolus in musica.
Cette perception prédisposait Jouve à comprendre pleinement le dodécaphonisme, qui est en somme une théorie de la dissonance généralisée, justifiée par le fait que la notion de consonance ou d’accord parfait n’est pas « naturelle » mais profondément culturelle, comme le prouve la comparaison de la musique occidentale avec les autres musiques du monde.
7. Poésie et dissonance : une lecture de « Musique »
Poétiquement, le problème qui va se poser est de parvenir à faire entendre la dissonance en poésie, c’est-à-dire, pour rivaliser en puissance ontologique avec la musique, à créer des objets verbaux chargés de la plus grande tension possible. Mais comment permettre au poème d’être enfin dissonant ? La réponse ne peut-être cherchée que du côté de l’agencement des significations. La phrase jouvienne, par le recours aux doubles possibilités de la sémantique et de la syntaxe, tendra le plus possible aux effets de suspension et de discordance. Or de ces effets, c’est peut-être la fin du poème Musique (997) qui offre l’un des meilleurs exemples.
Le premier quatrain énonce en quelque sorte un thème en caractérisant la musique comme onde, ondulation, remous, et en condensant en quelque sorte en épopée l’aventure musicale — le « conte de nous-même » qu’est la musique — d'où l'imparfait employé :
Souvent tel un printemps répandu sur la mer
J’ai suivi les remous des cordes, bois et cuivres :
Sauvage allait la cavalière de la mort
Sonnant l’orage pour le malheur de la terre ;
C’est avec le second quatrain que le suspens commence ; car si l’adjectif douce peut encore se rapporter à la cavalière, on cherchera en vain ici un verbe, et, partant, un moyen de fixer définitivement le sens du second quatrain :
Ou douce de ses oiseaux déchirants, un soleil
Dans les pleurs, et le chant raisonnable des anges
Ayant séduit la bête avec un œil soyeux
Pour l’idylle du temps l’éternelle louange ;
Il est possible (entre autres) qu’il faille sous-entendre dans le quatrième vers de cette strophe une reprise de « j’ai suivi », mais six vers se sont écoulés et le verbe n’est plus vraiment présent à la conscience du lecteur, même après plusieurs lectures ou auditions du poème, d’autant que des éléments très forts ont détourné son attention. L’absence quasi totale de ponctuation ne facilite pas la compréhension : deux virgules seulement pour mettre en valeur l’épithète déchirants par lequel nous retrouvons l’analogie du son et de l’oiseau relevée dans Grégorien, mais cette fois-ci suggérant l’idée du cri convulsif et non du vol serein, deux virgules qui permettent aussi le rejet « un soleil / dans les pleurs ». Ce procédé est fait pour égarer et pour qu’au quatrième vers l’idylle du temps et l’éternelle louange soient placées côte à côte sans qu’on puisse dire s’il faut chercher un lien logique entre les deux et dans quel sens il faut entendre « pour », ou si elles sont, par une simple apposition, deux façons de nommer la même chose.
Or ce quatrain est construit sur une citation cachée — procédé que l’on rencontre souvent chez Jouve comme chez de nombreux musiciens : le choral de Bach cité dans le Concerto à la mémoire d’un ange en est un exemple entre mille — qui provient d’Une Saison en Enfer de Rimbaud. C’est à un passage de Mauvais sang en effet que Jouve emprunte l’expression « le chant raisonnable des anges ». Citons-le :
Le chant raisonnable des anges s’élève du navire sauveur : c’est l’amour divin. — Deux amours ! je puis mourir de l’amour terrestre, mourir de dévouement.
Or il est probable qu’il n’y a pas chez Jouve de volonté érudite de signaler dans l’expérience musicale une sorte de « descente aux enfers », même si c’est aussi cela qu’il veut dire, mais qu’il y a bien de sa part ici une appropriation complète, avec tout de même en toile de fond cet effet pour ainsi dire caché (car il est peu probable que beaucoup de lecteurs identifient avec précision l’allusion rimbaldienne). Ce chant raisonnable qui fait résonner la raison (si l’on ose s’autoriser du Pour un Malherbe de Francis Ponge pour proposer ce jeu de mot), devient ici l’emblème même de la convergence possible entre poésie et musique : la pure rationalité du Nombre qui sert de fondement à la musique n’a de sens que guidée par l’inspiration, le suspens du sens dans lequel la musique du poème trouve à s’épanouir est un tremblement contrôlé, raisonné du sens.
L'obscurité de Jouve – réelle – n'est pas une « élégance », comme il est arrivé à Paul Veyne de l’affirmer de celle de Char, ni un hermétisme volontaire, mais une tentative de fondre entre elles les significations pour produire un effet musical. C’est dans l’hésitation entre différentes significations rationnelles dont aucune n’est satisfaisante que s’épanouit le miracle proprement musical de la poésie, qui est attente indéfinie de la résolution, semblable à l’attente que provoque en musique la dissonance sur l’auditeur. Dans le troisième tercet, on croirait volontiers que le poème se désigne lui-même en caractérisant la musique, de façon oxymorique, comme « discours infiniment tu » :
Discours infiniment tu par l’intime étrange
O gloriole des sons esprit de vision
Mystère entier comme est cette humaine saison.
Ici la ponctuation a entièrement disparu. L’expression l’intime étrange est non seulement un deuxième oxymore dans le même vers, c’est aussi un exemple de suspension indéfinie du sens d'un point de vue grammatical, car il est impossible d’assigner un statut à ces deux mots, de dire lequel est substantif et lequel adjectif. Création proprement magique de Jouve, fascinante ambiguïté de la voix, et de la raison qui ne parvient plus à séparer l'essence de l'accident. La présence du monosyllabe « tu » juste après la coupe de ce rythme d’alexandrin crée, du point de vue du rythme, un heurt de deux accents forts au cœur du vers sur deux syllabes successives, un effet de syncope.
Or il est bien probable que « l’intime étrange », ce soit la Mort, cette étrangère aux portes de la Cité dont nous parle Épicure, qui fait notre siège et pourtant habite déjà au dedans de nous : nul mur ne nous défendra. Mais la Mort qui se trouve ainsi désignée est saisie dans le mystère de son suspens, de son ambiguïté innommable, mieux que par l’allégorie de la « sauvage cavalière » du début.
On pourrait multiplier les exemples de ce déplacement subtil du sens qui se trouve généralisé dans ce poème, souligner combien il est difficile de savoir quel sens donner au mot gloriole, qui veut normalement dire ostentation, vaine gloire — mot forgé par Bernardin de Saint-Pierre sur un mot latin dont Cicéron use dans sa correspondance, mot par conséquent assez récent en français. Or il est probable que ce mot n’a pas pour Jouve ici un sens péjoratif, à moins qu’il ne veuille désigner, de nouveau, une excessive prétention de la musique. Mais le lecteur (l'auteur de ces lignes du moins) l’entend plutôt comme un synonyme de gloire, et dirait-on presque comme la contraction du mot gloire et du mot auréole (intuition dont chacun appréciera la valeur à l’aune de ses propres associations d’idées). Ainsi du moins le poème parvient-il à mimer « l’imprévu » que Jouve reconnaît comme qualité majeure à l’œuvre musicale (1117), à se faire de nouveau « invention » — mais c'est là un nouveau point de convergence entre poésie et musique dont l'analyse nous entraînerait trop loin1.
Ce n’est pas trop de dire que ce poème de Jouve pose la poésie et la musique non pas en situation de rivalité mais de coïncidence, de coprésence dans l’expérience poétique du réel. La rivalité apparente se résout en défi relevé, puis en complémentarité qui porte la poésie au-delà d’elle-même, la force à s’inventer une forme, à ne pas trahir l’exigence des « vocalises de durable vocation ». Jouve n’écrit-il pas, s'adressant à Dieu dans Moires, qu’il souhaite une éternité où les deux arts rivaux soient réconciliés, dans cette lucidité à laquelle Rimbaud voulut atteindre dès le séjour sur cette terre :
Si Tu me donnes l’éternité sous quelque forme,
Que je garde la touche avec mes grands objets
Poésie et musique
Et que je les entende en orbes éternels
(Sinon je me refuse à la suite éternelle)
Bien plus lucidement que jamais je ne fais. (1086)
Il y a dans la recherche de Jouve, dans son amour du monde sensible et des leçons sensuelles de la musique, une lucidité artistique et humaine qui peut aujourd'hui nous guider sur le chemin du poème, à l’écoute nous aussi du « chant raisonnable » de ses anges écartelés entre terre et ciel.
Jean-Yves Masson
Université Paris-Sorbonne
(CRLC)

Source
Pierre
Jean Jouve,
actes du colloque de Nice (24-26 novembre 1994) sous la direction de
Béatrice Bonhomme et Christiane Blot-Labarrère, Arras, Presses de
l’Université d’Artois, supplément de la revue Roman
20-50,
série « Actes de Colloques », 1997, p. 153-167.
- Un entretien avec Jean-Yves Masson sur le site de L'Association des anciens élèves, élèves et amis de l’Ecole normale supérieure : "En France, comme vous le savez, on n'aime pas les traductions".

Ce texte © Jean-Yves Masson
Première mise en ligne : 11 février 2013

Retour à la Page d'Accueil du Site
Site Pierre Jean Jouve
Sous la Responsabilité de Béatrice Bonhomme et Jean-Paul Louis-Lambert